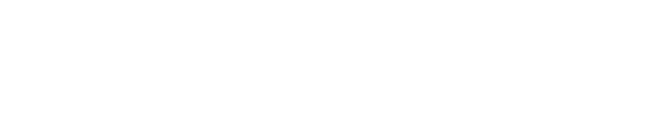Abbaye du Mont-Cassin 1943-1944…
Le 15 février 1944, en quelques heures à peine, la vénérable abbaye du Mont-Cassin fut anéantie par quatre cent cinquante-trois tonnes de bombes lâchées en huit vagues successives par deux cent trente-neuf bombardiers[1].
Il convient toutefois de souligner l’injustice qui accompagne l’indignation silencieuse suscitée par ce « plus formidable bombardement de l’histoire dirigé contre une cible unique ».
Jusqu’à ce jour, aucun procès ne fut jamais intenté contre les artisans du désastre. Les Etats-Unis, l’Angleterre et même le centre Simon Wiesenthal reconnaissent que ce fut une « tragique erreur » puisque, contrairement à ce que croyaient les Alliés, les Allemands n’avaient pas transformé l’abbaye en poste d’observation. Mais c’est tout. Quand on appartient au camp des croisés de la démocratie, le crime que l’on commet ne saurait s’appeler un crime.
De plus, une odieuse ingratitude demeure : on omet de saluer le courage et l’abnégation de ceux qui avaient su préserver de la rage destructrice les biens les plus précieux de cette vénérable fondation, à un moment où ils auraient pu sans aucune faute se consacrer uniquement à leurs devoirs strictement militaires.
Afin de combler cette scandaleuse lacune, rappelons les faits.
Entre le 18 janvier et le 12 mai 1944, les troupes allemandes ont stabilisé le front de la bataille d’Italie sur la ligne Gustav qui passait à proximité de l’abbaye du Mont Cassin.
Comme la zone de combat s’approchait dangereusement du monastère, et redoutant le manque de scrupules de ses adversaires, le commandement allemand proposa aux autorités religieuses [dès le 14 octobre précédent] de transporter en lieu sûr (au Vatican) les principales reliques et œuvres d’art, en plus des moines qui le souhaitaient, ainsi que les membres de trois communautés de moniales, ce qui fut finalement accepté et effectué en une opération de grand style.
Les tableaux les plus précieux, les manuscrits, les incunables et 70 000 volumes de la bibliothèque furent empaquetés dans des caisses fabriquées sur place et sur mesure par les menuisiers de l’intendance de la division Hermann Göring.
Finalement, une colonne de camions transporta de nuit personnes et trésors jusqu’à la frontière de la Cité du Vatican, c’est-à-dire à la limite extérieure de la Place Saint-Pierre à Rome[2].
 Deux mois après la fin des opérations, l’antique monastère fut pulvérisé de la manière sauvage que l’on sait.
Deux mois après la fin des opérations, l’antique monastère fut pulvérisé de la manière sauvage que l’on sait.
Sans l’action magnanime des « hordes germaniques », les trésors artistiques et documentaires qui y étaient conservés auraient disparu à jamais pour la postérité.
Ce mérite attend toujours un merci des prétendus « civilisés ».
Pour les lecteurs moins pressés…
Nous reproduisons ci-dessous le récit détaillé du sauvetage, tel qu’on peut le lire dans le livre de Rudolf Böhmler, Monte Cassino[3].
L’auteur commandait, au moment des faits, le 1er bataillon du 3e Chasseurs-Parachutistes allemand. Le général Chambe, préfacier de l’édition française, participa aux combats comme officier du Corps expéditionnaire français.
Une grande bataille prévue au pied du Monte Cassino
On était en octobre 1943.
Au poste de commandement de la division blindée Hermann Goering, des officiers se penchaient sur la carte que leur commandant, le général Conrath, avait étalée sur la table. Parmi eux se trouvait un officier supérieur d’un certain âge, né à Vienne, le lieutenant-colonel Jules Schlegel. Il commandait la compagnie de Réparations de la division [Instandsetzungsabteilung der Panzergrenadierdivision]. Cette dernière était encore à Capoue, l’attaque de la 5e armée américaine sur le Volturno venait de débuter. Cependant, le sujet de la conférence concernait beaucoup moins la retraite imminente que les instructions données par le maréchal Kesselring pour les manœuvres ultérieures.
 Le général en vint à entrer dans les détails de la ligne Reinhard et, de manière plus détaillée encore, de la ligne Gustav qui venait d’être mise en chantier. Il expliqua à ses officiers que l’offensive alliée devait y être arrêtée de manière définitive, que le terrain allait y être défendu contre l’adversaire, sans idée de recul. Il fallait s’attendre à voir le centre des combats pour la conquête de la ligne Gustav se cristalliser dans la vallée du Liri et sur les hauteurs de part et d’autre de celle-ci. Il s’était attardé longtemps sur le Monte Cassino et expliqua clairement à ses officiers l’importance tactique de celui-ci (voir carte).
Le général en vint à entrer dans les détails de la ligne Reinhard et, de manière plus détaillée encore, de la ligne Gustav qui venait d’être mise en chantier. Il expliqua à ses officiers que l’offensive alliée devait y être arrêtée de manière définitive, que le terrain allait y être défendu contre l’adversaire, sans idée de recul. Il fallait s’attendre à voir le centre des combats pour la conquête de la ligne Gustav se cristalliser dans la vallée du Liri et sur les hauteurs de part et d’autre de celle-ci. Il s’était attardé longtemps sur le Monte Cassino et expliqua clairement à ses officiers l’importance tactique de celui-ci (voir carte).
Un Allemand, Schlegel, prévoit que les avions alliés ne respecteront pas Monte Cassino.
Cette constatation attira l’attention de Schlegel, amateur d’art et visiteur assidu des musées et sites artistiques d’Italie, il n’en attendait rien de bien. À l’idée que la bataille décisive allait faire rage au pied de cette montagne que couronnait un joyau d’art unique, il en prévoyait le désastre. Un danger mortel le menaçait. Schlegel savait combien peu pèseraient les scrupules dans l’ardeur des combats, combien peu d’égards avait eus, jusqu’alors, cette guerre cruelle pour les habitations et les centres artistiques ; il avait eu connaissance des graves dégâts subis par la célèbre église Saint-Laurent au cours du bombardement de Rome [par les Alliés], le 19 juillet. Il avait vécu les événements de Sicile, où les bombardiers anglo-saxons anéantirent des villes et des villages entiers. Allaient-ils faire halte devant le Mont Cassin ? Allaient-ils respecter la sainteté et la valeur culturelle de ce haut lieu ?
Quoi qu’il en fût, Schlegel ne pouvait pas y croire. Déjà, la seule proximité de Cassino traversée par la Via Casilina, la voie d’accès à la Rome tant désirée, faisait entrevoir des raids aériens alliés. Avec quelle facilité des bombes larguées trop tôt ou trop tard n’allaient-elles pas tomber sur la maison de saint Benoît ? Et l’artillerie ? Cette dernière n’allait-elle pas lui être encore plus fatale ? Les obus allemands ou américains n’allaient-ils pas, dans leur trajectoire, être arrêtés au sommet de la montagne et exercer leur fureur dévastatrice sur les bâtiments et les œuvres d’art du couvent ?
Schlegel bien décidé à agir.
Schlegel était aviateur et artilleur, il pouvait donc mesurer toutes les conséquences de l’orage qui amoncelait ses nuages au-dessus de la vénérable abbaye. Ces idées le tourmentaient sans cesse. Il connaissait bien les trésors du Mont-Cassin, leur splendeur et leur valeur inestimable. Une voix intérieure lui commandait d’agir, au moins de tenter quelque chose. Mais comment allait-il s’y prendre ? De quel droit ? Que dirait le tribunal militaire si, de sa propre autorité, ne tenant aucun compte de ses devoirs de soldat, il allait employer des hommes, des véhicules, de l’essence si précieuse et de l’huile dans une entreprise qui poursuivait toute autre chose qu’un but militaire ou même stratégique ? Et si, par la suite, le couvent n’allait pas être bombardé du tout ? Si les combats allaient prendre une toute autre tournure ou si les Alliés allaient tout de même respecter l’inviolabilité du monastère ? Qu’adviendrait-il alors ? Alors, personne ne pourrait le couvrir, il serait jugé très sévèrement. Pourtant une voix lui disait : « Tu dois le faire ! » Elle devait lui rappeler Cassino dont le palais épiscopal avait déjà été bombardé ou bien la route en lacets conduisant au couvent où des bombes avaient déjà explosé. La même épée mortelle n’était-elle pas suspendue au-dessus du monastère ?
Un Père Abbé qui ne voit pas le danger.
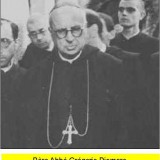 Le 14 octobre [1943], Schlegel était assis dans sa voiture qui le menait vers le couvent. Derrière lui se trouvait un Tyrolien du Sud qui devait lui servir d’interprète dans ses conversations avec le Père Abbé. Peu après, Schlegel se trouva face à face avec le Père Abbé Gregorio Diamare. Il n’était pas facile de faire comprendre à l’abbé le danger qui menaçait le monastère, car celui-ci ne croyait pas à un tel danger. Il était convaincu, dur comme fer, que les alliés allaient avoir pour les disciples de saint Benoît les mêmes égards et le même tact dont les Allemands avaient fait preuve depuis le début. L’accès du couvent avait bien été autorisé aux militaires allemands, mais sans armes et sous la conduite d’un moine. Kesselring ne plaisantait pas en cette matière ! Jusqu’alors, il n’y avait pas eu le moindre incident, il était évident que les soldats allemands avaient reçu des instructions sévères.
Le 14 octobre [1943], Schlegel était assis dans sa voiture qui le menait vers le couvent. Derrière lui se trouvait un Tyrolien du Sud qui devait lui servir d’interprète dans ses conversations avec le Père Abbé. Peu après, Schlegel se trouva face à face avec le Père Abbé Gregorio Diamare. Il n’était pas facile de faire comprendre à l’abbé le danger qui menaçait le monastère, car celui-ci ne croyait pas à un tel danger. Il était convaincu, dur comme fer, que les alliés allaient avoir pour les disciples de saint Benoît les mêmes égards et le même tact dont les Allemands avaient fait preuve depuis le début. L’accès du couvent avait bien été autorisé aux militaires allemands, mais sans armes et sous la conduite d’un moine. Kesselring ne plaisantait pas en cette matière ! Jusqu’alors, il n’y avait pas eu le moindre incident, il était évident que les soldats allemands avaient reçu des instructions sévères.
Le seul fait que l’abbé avait accordé à des milliers de civils italiens l’asile du couvent et, aussi, que rien n’avait été envisagé qui puisse laisser croire à l’éventualité d’une évacuation de l’abbaye, démontre sans ambiguïté que les Cassiniens n’avaient jamais songé que la guerre allait également détruire leur maison sous ses coups. Bien sûr, en bas, à Cassino, la guerre avait déjà laissé des traces. Outres la destruction du palais épiscopal, il y avait eu d’autres dommages graves à déplorer. Cependant, Cassino était un défilé important, facile à barrer, par lequel s’écoulaient les ravitaillements allemands vers le front du Volturno.
Alors Schlegel se posa le problème : comment faire comprendre à l’abbé qu’il était dans l’erreur totale en croyant que le Mont-Cassin était hors de tout danger ? Schlegel devait tout faire pour ébranler cette assurance, avec beaucoup de tact et sans pouvoir, devant l’abbé très âgé, nommer les choses par leur nom. Le lieutenant-colonel ne pouvait laisser transpirer un mot sur les intentions du commandement allemand de faire face à l’ennemi sur la ligne Rapido-Garigliano, rien ne devait laisser conclure que la résistance allemande sur les positions avancées devant Cassino ne serait que d’une durée limitée.
Première visite au couvent, premier entretien.
C’est à tâtons que Schlegel se mit à l’œuvre. Il fut heureux de rencontrer l’assistance du Père Emmanuel Munding, un moine allemand qui avait été détaché pour cinq ans à Cassino par son couvent de Beuron. Il accompagnait l’abbé probablement comme interprète. Schlegel ayant au début de l’entretien indiqué que des bombes étaient déjà tombées à proximité du monastère, le père abbé Diamare répliqua que les avions ne détruiraient jamais le Mont-Cassin. Il n’admit pas l’objection de Schlegel quand celui-ci lui affirma que des bombes ou des obus égarés pourraient causer des dommages parmi les moines et les réfugiés ainsi que parmi les trésors artistiques du couvent. Le monastère ne recélait certainement pas tant de trésors que le lieutenant-colonel voulait bien croire. Il est évident qu’il se méfiait de l’officier allemand et suspectait Schlegel de cacher une tentative allemande d’enlever des trésors du couvent et peut-être l’intention de les transférer en Allemagne. Peut-être la propagande alliée a-t-elle contribué pour sa part à réveiller la méfiance du vieil abbé.
Schlegel découvre les trésors renfermés dans le monastère.
Le bibliothécaire Dom Mauro qui s’était joint à la conversation considérait avec encore plus d’ombrage l’hôte indésirable. Sans aucun doute, il soupçonnait un danger et il voyait en Schlegel « le loup dévoreur de livres, dans la peau d’un agneau ». Il ne put cependant pas contrevenir aux ordres de son abbé lorsque celui-ci accorda à Schlegel la permission de visiter la bibliothèque. C’est là que le lieutenant-colonel eut le premier aperçu du précieux trésor, conservé derrière les murs du Mont-Cassin depuis des siècles avec un soin jaloux — et c’était justement lui et ses soldats qui allaient devoir le conserver à la postérité, tout au moins ses éléments ayant le plus de valeur. Aux « Archives », où dormaient les vieux parchemins, les codex et les incunables, le merveilleux passé de Monte-Cassino quittait son voile. Schlegel en fut frappé et Dom Mauro devint visiblement plus accessible lorsqu’il s’aperçut de l’intérêt réel et sincère de son hôte.
Des résultats décevants.
Le premier entretien avec le père abbé n’avait pas eu de grand résultat, son succès était loin de ce que Schlegel en avait attendu. Sans aucun doute, il n’était pas parvenu à ébranler l’assurance de Diamare qui ne pouvait s’imaginer qu’on pût faire du mal à la maison de saint Benoît. En fin de compte, n’avait-on pas affaire à des gens civilisés et non pas à de sauvages barbares comme, jadis, les Lombards et les Sarrasins ? Une chose pourtant était acquise : la confiance du Père Emmanuel. Schlegel avait pu lui faire, en allemand, certaines insinuations et au départ du lieutenant-colonel, le moine allemand le pria de revenir et de mettre les habitants du couvent en garde s’il y avait péril en la demeure. C’est ce que Schlegel allait faire consciencieusement. Entre-temps, le Père Emmanuel allait encore une fois voir le père abbé et lui faire saisir le danger qui menaçait réellement le monastère.
Un deuxième entretien qui porte ses fruits.
Le lieutenant-colonel ne se fit pas longtemps attendre. Dès le lendemain, il se fit annoncer chez l’abbé. Outre le Père Emmanuel et Dom Mauro, Dom Gaetano, prieur du couvent, assistait à la discussion. C’était un homme digne et âgé, portant une tête caractéristique de savant. Cette fois, l’atmosphère s’était réchauffée. La première visite de Schlegel avait, à coup sûr, produit son effet. Le prieur et le Père Emmanuel encouragèrent avant tout Schlegel à présenter son point de vue avec plus d’insistance. Il est certain que l’assurance du père abbé fut ébranlée, lorsque l’officier allemand lui eut fait un tableau peu reluisant de la situation militaire et lui eut proposé de conduire dans sa voiture un représentant du couvent qui se rendrait au Vatican pour solliciter l’aide du pape. Gregorio Diamare lui répliqua que l’on ne pouvait pas en attendre grand-chose. S’était-il mis en rapport avec Rome, entre-temps ? L’abbé reconnaissait-il tout de même le danger ? Schlegel se fit encore plus précis. S’il ne mentionna pas les combats imminents sur la ligne Gustav, il fit cependant comprendre que le Mont-Cassin pourrait devenir le centre du champ de bataille si les Alliés allaient entreprendre un débarquement dans cette zone en exploitant le flanc maritime allemand.
Cet argument fut frappant. Le père abbé, jusqu’alors tellement sûr de lui-même, fut tout à coup terrifié. Saisi d’angoisse, il se mit à trembler de peur. Alors, il fallait donc s’attendre au pire ?
Schlegel offre son aide pour évacuer le couvent.
Schlegel s’empressa d’offrir son aide, quoique ne voyant pas encore comment il allait pouvoir remplir une telle promesse d’assistance. Ne s’était-il pas un peu trop avancé ? Comment allait-il pouvoir mettre tous ces objets de valeur en lieu sûr ? Il ne possédait ni une entreprise de transports, ni d’inépuisables sources d’essence pour alimenter les nombreux camions nécessaires au transport des trésors du monastère. Sans l’accord du général Conrath, il ne pouvait être question de monter une opération de cette envergure et comportant de telles responsabilités.
Les choses étant ce qu’elles étaient, il n’était pas recommandé de les bousculer. C’est ainsi que Schlegel conseilla au père abbé de convoquer auparavant le chapitre et d’en délibérer à fond avec ses moines. Il reviendrait dans deux jours pour prendre connaissance de la décision du chapitre. Au moment de partir, il fut retenu par le Père Emmanuel qui insista pour que le lieutenant-colonel tienne sa promesse et revienne au monastère. De son côté, le Père ferait son possible pour faire pencher l’opinion du couvent dans le sens proposé par Schlegel.
La glace se brise entre le père abbé et l’Allemand.
Sur ces entrefaites, la 5e armée américaine avait franchi le Volturno et avançait en direction de Rome, vers Cassino, vers le mont Saint-Benoît. Il est certain que le succès du général Clark n’a pas été sans influencer la décision du chapitre ; lorsque Schlegel se présenta, à la date fixée, sur la montagne, les dés étaient jetés. Non seulement le père abbé marqua son accord pour saisir la main secourable de Schlegel, mais il alla jusqu’à prier le colonel de se charger de la maison de saint Benoît et assura cet officier supérieur qu’il collaborerait à l’œuvre de sauvetage par tous les moyens disponibles.
La première proposition de l’officier allemand fut d’envoyer, le jour même, un camion au couvent qui serait chargé au gré de la communauté monacale et de l’expédier à Rome, accompagné de deux moines désignés par le Père Abbé. C’est là qu’après déchargement du véhicule lesdits moines devaient délivrer un récépissé qui serait ensuite transmis au Père Abbé. C’est avec reconnaissance que Gregorio Diamare accepta cette proposition. La glace fut enfin définitivement rompue lorsque, le lendemain, Schlegel remit au supérieur du couvent l’attestation en question. Maintenant le Père Abbé avait entièrement confiance. Il insista auprès du colonel pour que les travaux de sauvetage commencent le plus rapidement possible, se mit presque aux ordres de Schlegel et promit de faire en sorte que les ordres de l’officier allemand soient exécutés par tous les habitants du monastère. Tous les intéressés peuvent témoigner de la réserve bienveillante et du tact dont Schlegel fit preuve. Il ne fit aucun usage de l’offre ci-dessus. Par la suite, il discuta de toutes les mesures qu’il estimait nécessaire de prendre, avec Dom Gregorio ou avec l’un de ses collaborateurs les plus proches.
Une tache gigantesque et dangereuse.
Ainsi, Schlegel avait assumé une lourde responsabilité. Lorsqu’il offrit son assistance, il ne s’était certes pas rendu compte clairement de l’ampleur qu’allait prendre son entreprise de sauvetage. Il n’avait certainement pas prévu que 120 camions suffiraient à peine pour évacuer au moins les objets les plus précieux. Le chemin menant à Rome était long, il y avait bien 140 kilomètres et le ciel appartenait à l’adversaire. Il était donc à craindre que des chasseurs-bombardiers américains ou britanniques prennent pour cibles les camions chargés de biens pacifiques et que, de cette manière, des valeurs culturelles irremplaçables ne soient détruites, tandis qu’il restait encore à déchiffrer dans les étoiles si l’aviation alliée allait étendre son bras dévastateur jusque sur l’abbaye elle-même. Des journées pleines d’angoisse attendaient le courageux officier. Et le moindre de ses soucis n’était pas l’ignorance dans laquelle Schlegel avait laissé tous ses supérieurs de ses projets qu’il avait déjà commencé à mettre à exécution. Même le général Conrath ignorait tout de ce qui se passait au Mont-Cassin — et Conrath était un monsieur pas commode !
Le cas des réfugiés au monastère.
Et maintenant un obstacle nouveau devait survenir et barrer à Schlegel la route de manière presque insurmontable : les innombrables réfugiés auxquels, conformément à la règle bénédictine, Gregorio Diamare avait accordé un toit et une hospitalité fraternelle : ne leur avait-il pas généreusement fait don de vivres prélevés sur les réserves de l’abbaye ? Dans les cours et les locaux du collège et du séminaire diocésain que l’abbé avait fait séparer du reste du couvent par un mur, près de 1 100 personnes s’étaient installées avec tous leurs biens sur la sainte montagne. Il y avait même des familles entières. Les moines n’avaient mis personne à la porte, ils avaient accordé à tous l’abri du couvent, bien que celui-ci ne fût pas organisé pour recevoir de telles foules humaines. Ces réfugiés devenaient maintenant très gênants. Il fallait les évacuer, d’une part pour leur propre sécurité, d’autre part, il n’était pas prudent de procéder en présence de tant de personnes au transfert des précieux trésors du couvent, véritables bijoux d’orfèvrerie d’or et d’argent massifs, d’une valeur inestimable.
Naturellement, il n’était pas possible que le père abbé revienne brusquement sur sa décision et expulse brutalement les réfugiés du couvent. Schlegel s’en rendait bien compte. Il ne lui restait plus qu’à recourir à un stratagème : le lieutenant-colonel rassembla les réfugiés dans l’une des cours, il leur fit comprendre qu’il n’ignorait pas que bien des choses leur manquaient puisque ce couvent n’avait pas été fait pour tant de personnes. Souiller comme ils le faisaient non seulement les cours, mais également les chambres de l’abbaye, était une bien singulière manière de témoigner aux moines la reconnaissance due pour leur si aimable hospitalité. Il devenait donc nécessaire de « ravaler les lieux » pour éviter la menace d’épidémie provoquée par l’insuffisance des installations sanitaires du couvent. Cela ne paraissait pas sourire à son auditoire. Pourtant, Schlegel ne fut pas déçu dans son secret espoir : la plupart des réfugiés ne tardèrent pas à déménager. Il importe peu de savoir si ce fut de peur des épidémies ou par ignorance des principes élémentaires d’hygiène ou, encore, pour esquiver les corvées. Il ne resta qu’un groupe d’éléments aimant la propreté, de gens comme il faut ; par la suite, ils se révélèrent de précieux auxiliaires pour l’emballage et le chargement des objets d’art et ils ne se livrèrent à aucun larcin.
L’évacuation commence.
Au début, les camions envoyés par Schlegel sur la colline furent chargés sans plan préétabli. Comme le premier, les transports suivants furent chaque fois accompagnés de deux religieux qui entrèrent à Rome et envoyèrent fidèlement au Mont-Cassin confirmation de l’arrivée en bon état des objets ainsi transportés. Le déroulement méthodique, l’ordre et la régularité des opérations enthousiasmèrent les moines qui admirèrent les qualités d’organisation des Allemands. Après s’être rendu compte de ce que tout s’était si bien passé, ils insistèrent pour que l’on mette en lieu sûr les archives et la bibliothèque, objets les plus précieux du monastère.
Une fabrique de caisses improvisée.
 Mais c’était plus vite dit que fait, car certains préparatifs étaient indispensables et Schlegel en avait déjà partiellement commencé la réalisation. Il n’était pas possible de charger les précieux parchemins et codex en vrac et sans emballage dans les camions, car ils auraient pu facilement être endommagés au cours du voyage par les secousses et le frottement. Seules, des caisses pouvaient permettre un transport convenable.
Mais c’était plus vite dit que fait, car certains préparatifs étaient indispensables et Schlegel en avait déjà partiellement commencé la réalisation. Il n’était pas possible de charger les précieux parchemins et codex en vrac et sans emballage dans les camions, car ils auraient pu facilement être endommagés au cours du voyage par les secousses et le frottement. Seules, des caisses pouvaient permettre un transport convenable.
 Schlegel sut se débrouiller. Il installa au couvent une véritable fabrique de caisses. Il se fit apporter les planches nécessaires d’une usine de boissons qu’il avait trouvée entre Cassino et Teano. La plupart des outils furent fournis par l’échelon de réparations placé sous ses ordres, ainsi qu’une armée d’ébénistes et de menuisiers (voir photo).
Schlegel sut se débrouiller. Il installa au couvent une véritable fabrique de caisses. Il se fit apporter les planches nécessaires d’une usine de boissons qu’il avait trouvée entre Cassino et Teano. La plupart des outils furent fournis par l’échelon de réparations placé sous ses ordres, ainsi qu’une armée d’ébénistes et de menuisiers (voir photo).
Le reste de la main-d’œuvre fut recruté parmi les civils restés au couvent. Il obtint de l’abbé des rations complètes pour cette main-d’œuvre et leur distribua, chaque jour, un paquet de cigarettes prélevé sur les stocks de l’officier de détail de son unité. Il stimula ainsi le zèle des Italiens et, quelques jours après, la menuiserie avait fourni quelques centaines de caisses, un véritable travail à la chaîne. Il faut y ajouter des cadres et des châssis de protection pour les tableaux ainsi qu’un grand nombre de coffres pour la conservation des objets. Tout allait comme sur des roulettes. Dès qu’une caisse était terminée, elle allait immédiatement aux archives ou à la bibliothèque où, sans retard, on y empilait les pièces les plus précieuses, puis on la chargeait sur l’un des camions attendant dans la cour (voir photo). Et finalement, en route pour Rome ! Schlegel avait cru ne pouvoir sauver qu’une infime fraction des collections de documents et de livres. Mais lorsque l’opération de sauvetage put se poursuivre jour après jour et que l’on entrevit la possibilité de transporter en lieu sûr même des volumes moins précieux, la menuiserie du couvent ne parvint plus à faire face à la demande croissante de caisses. On se vit donc dans l’obligation d’expédier une grande quantité de volumes manuscrits en vrac, protégés uniquement par des tapis et des couvertures. Et malgré tout, ils sont arrivés à bon port.
C’est ainsi que purent être sauvés environ 70 000 volumes de la bibliothèque des archives. En tout cas, on a pu ainsi mettre en lieu sûr toutes les pièces uniques, tous les documents remontant à plusieurs siècles — au nombre de près de 1 200 — d’une valeur historique inestimable, revêtus des sceaux de Robert Guiscard, Roger de Sicile et de nombreux papes et souverains illustres[4].
D’autres trésors à mettre en sûreté.
Mais le sauvetage entrepris par les soldats allemands n’était pas terminé. Il y avait encore d’autres trésors d’une valeur inestimable à mettre en sûreté. En fin de compte, Schlegel dut s’efforcer de charger chaque véhicule au maximum et d’utiliser chaque coin disponible, car il assumait une lourde responsabilité. Il ne pouvait pas, à la légère, distraire du front un tonnage déjà rare, d’un front réclamant depuis la Sicile du carburant et des véhicules. C’est ainsi qu’en même temps que les trésors des collections de livres et de documents, d’autres objets précieux prirent la route. Souvent on manquait de châssis pour assurer le transport de ces derniers en de bonnes conditions.
Mesures de précaution lors des transports.
On en fut alors réduit à les charger cadre contre cadre, à peine protégés par des couvertures ou des chiffons et à leur faire effectuer ainsi le long voyage.
Des conducteurs, triés sur le volet, auxquels on avait fait comprendre tout particulièrement la grande responsabilité qui leur incombait, portaient le précieux chargement plutôt qu’ils ne le camionnaient.
On avait strictement prescrit aux conducteurs de conserver une distance de 300 mètres afin d’éviter que les chasseurs-bombardiers n’occasionnent de trop lourdes pertes. En fait, aucun véhicule ne fut atteint. C’est là un beau résultat si l’on songe qu’au total 120 camions, remplis à bloc avec les trésors du couvent, roulèrent ainsi vers le Nord en transportant des moines, des moniales et des orphelins. Une seule fois, on fut à deux doigts de la catastrophe lorsqu’un camion étranger à la caravane s’intercala de force entre deux véhicules de la colonne de sauvetage. Et c’est précisément l’intrus qui essuya le feu des aviateurs alliés, tandis que les voitures de Schlegel atteignirent Rome sans une égratignure.
La propagande alliée accuse les Allemands de piller le mont Cassin.
Jusqu’alors, tout s’était bien passé. De nombreux transports avaient atteint le but sans encombre, personne n’avait dérangé l’opération de sauvetage, tout marchait à souhait. Tout à coup, la situation changea et l’opération sembla vouée à l’échec. Ce fut une surprise lorsque les émetteurs alliés annoncèrent :
La division Hermann Goering pille le monastère du Mont-Cassin !
L’affaire devenait grave. On en parlait ouvertement, en la dénaturant complètement. Personne au monde ne se demandait si cette information était conforme à la réalité, si peut-être, les Allemands n’agissaient pas en parfait accord avec les moines. Sans plus, on fit confiance à la propagande de guerre alliée et l’on crut que des soldats allemands avaient violé la paix du monastère et s’emparaient brutalement de ses trésors. En outre, on avait désigné une certaine unité par son nom. Il allait sans dire que le commandant de la division intéressée y participait, et il y avait là de quoi alimenter une propagande pernicieuse.
Schlegel dans une situation délicate .
Schlegel se trouvait donc dans une situation peu enviable. L’opération entreprise semblait dépasser ses moyens. Si, au début, il n’avait envoyé qu’un seul camion puis, timidement, quelques autres, maintenant que l’Abbé et le Chapitre avaient eux-mêmes insisté pour l’évacuation des trésors, il aurait dû mettre en œuvre colonne sur colonne. Dans son sincère désir d’aider les moines, il leur avait donné le petit doigt, mais ceux-ci réclamaient maintenant toute la main. Du point de vue militaire, Schlegel avait naturellement dépassé de beaucoup ses attributions. Où avait-il pris le droit de tout simplement détourner un précieux matériel de sa destination première et stratégique ? Qui lui avait donné l’autorisation de déborder le cadre de ses obligations militaires et d’utiliser des soldats allemands pour l’exécution de travaux qui n’avaient aucun lien direct avec la conduite de la guerre ? Comment pouvait-il… ?
Depuis plusieurs jours, il accomplissait allégrement cette tâche et il n’en avait toujours pas rendu compte à son général. Ce dernier allait faire un beau tapage quand il apprendrait ces abus ! Allait-il se contenter de hurler ? Bien sûr que non. C’était là une affaire qui ne pourrait se régler que devant la cour martiale. Pensez donc ! Des camions et de l’essence… Inexcusable !
Et maintenant, la bombe venait d’éclater ! Et l’on avait cité le nom de la division. Cela pouvait mener loin, même si l’on avait bonne conscience, tout au moins en ce qui concerne le « pillage ».
Un colonel allemand est envoyé pour enquêter.
Le premier messager de mauvais augure ne se fit pas attendre. Il apparut sous la forme d’un colonel venant de « haut lieu » qui, certainement, avait mission de vérifier l’exactitude de l’information donnée par les Alliés et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires.
Au premier coup d’œil, on pouvait donner raison aux Alliés : des camions se trouvaient dans les cours et des soldats allemands s’empressaient de faire disparaître des caisses et des cadres sous leurs bâches. Le colonel se renseigna minutieusement pour savoir si Schlegel agissait sur ordre, ce qui incita celui-ci à masquer quelque peu la vérité. Avait-il été rendu compte de l’opération au commandant du groupe d’armées Sud ? Qui fournissait les véhicules et les hommes ? Et l’Abbé avait-il seulement demandé une aide aux Allemands ? Et, en fin de compte, Schlegel était-il expert en matière d’art ?
Les réponses à ces questions auront probablement quelque peu tranquillisé le colonel, d’autant plus que Schlegel insista sur le fait qu’il y avait péril en la demeure et que l’on n’avait guère le loisir de s’enquérir d’un expert en matière artistique ; le malheur pouvait fondre sur le couvent d’un jour à l’autre.
Et comme pour donner raison à Schlegel de manière frappante, à ce moment précis un nouveau bombardement se déclencha au-dessus de Cassino. Le colonel se contenta de jeter un regard rapide dans la basilique et prit congé, sans interrompre ni interdire l’œuvre de sauvetage.
La feldgendarmerie arrive sur les lieux.
Le colonel avait à peine passé la porte qu’une colonne accourut : feldgendarmerie ! Cela devenait inquiétant. Qui pouvait savoir quels ordres avait la prévôté ? Vingt hommes conduits par un officier, s’élancèrent dans le monastère. Schlegel alla à leur rencontre et leur demanda ce qu’ils venaient faire dans ce couvent. Ils avaient l’ordre du commandant du groupe d’armées Sud de se rendre compte si, réellement, il y avait eu pillage au couvent et, le cas échéant, de se saisir des coupables. Schlegel invita l’officier commandant le détachement à s’adresser aux moines, qui lui expliquèrent la situation, et il ne lui resta plus qu’à s’excuser et à déblayer le terrain avec ses gendarmes.
Les SS, sempiternels accusés.
Leccisotti qui, par ailleurs, ne tarit pas de louanges sur la délicatesse avec laquelle Schlegel procéda au déménagement, note, au sujet de cet épisode, que Schlegel aurait même poussé le respect jusqu’à « mettre énergiquement à la porte du couvent un groupe de SS qui y auraient pénétré à la recherche d’hommes et d’objets. »[5] Il se peut que le bon Dom Tommaso ait observé la scène mais il ne pouvait pas comprendre un mot de la conversation entre Schlegel et l’officier de la prévôté aux armées puisqu’il ignorait la langue allemande.
Lorsque les gendarmes se retirèrent, il pensa certainement que Schlegel s’était débarrassé d’eux. Il ne pouvait pas penser que la prévôté était accourue sur la montagne pour protéger le monastère, car il s’imaginait que celle-ci était venue dans une toute autre intention. Selon la propagande alliée, les SS étaient destinés à ces basses besognes et ainsi Leccisotti avait transformé les paisibles gendarmes en SS maraudeurs.
Je n’ai jamais eu l’occasion de mettre des militaires SS à la porte, pour la bonne raison qu’il n’en est jamais venu[6] a déclaré Schlegel à l’auteur.
Il est intéressant de remarquer quelle influence la propagande alliée avait eue, même sur les moines du Mont-Cassin. Il faut, par ailleurs considérer que Leccisotti a écrit son livre immédiatement après la guerre — la première édition a paru dès 1947 à Florence — à une époque où le recul manquait encore pour juger les événements de la seconde guerre mondiale.
Le général allemand encourage les mesures d’évacuation.
À la suite de ces incidents, on ne pouvait plus rester sans mettre au courant le général Conrath, ce qui aurait déjà dû être fait depuis longtemps. Il était urgent de l’informer de cette évacuation avant qu’il n’en ait connaissance par d’autres voies. Ces pensées ont dû travailler Schlegel. Comment allait-il pouvoir faire admettre au général commandant la division ce procédé cavalier d’agir de sa propre initiative ? Comment obtenir son consentement à la continuation de cette action de sauvetage ?
Le salut lui apparut en la personne du lieutenant-colonel breveté Bobrovsky, chef du 4e Bureau de la division Hermann Goering. Schlegel était son confident et, de son côté, Bobrovsky était persona grata auprès de son général. Il pouvait servir d’intermédiaire. Le général Conrath ignorait lui-même encore tout des communiqués de la radio alliée, lorsque Schlegel et Bobrovsky se présentèrent à lui. Les deux officiers lui dépeignirent avec force détails l’immense importance du Mont Cassin et de ses trésors artistiques, que Schlegel avait déjà commencé à mettre en lieu sûr. Toutefois, ils évitèrent de révéler au général toute l’importance qu’avait déjà prise l’opération de sauvetage ; ils pensaient le faire peu à peu. On ne pouvait pas savoir ! Ces nombreux camions, tous ces mètres cubes d’essence !
 Mais voyez ! Le général n’était pas du tout le sauvage que la mauvaise conscience de Schlegel s’était, jusqu’alors, représenté. Bien au contraire ! Il approuva totalement les mesures prises par Schlegel, ordonna leur continuation et alla même jusqu’à prescrire l’augmentation des moyens et du personnel mis en œuvre (voir photo).
Mais voyez ! Le général n’était pas du tout le sauvage que la mauvaise conscience de Schlegel s’était, jusqu’alors, représenté. Bien au contraire ! Il approuva totalement les mesures prises par Schlegel, ordonna leur continuation et alla même jusqu’à prescrire l’augmentation des moyens et du personnel mis en œuvre (voir photo).
C’était la victoire sur toute la ligne !
Schlegel découvre l’existence d’un nouveau trésor dans le monastère.
Maintenant, Schlegel déchargé du lourd fardeau qui l’opprimait, pouvait donner plus d’envergure à son action, il allait pouvoir satisfaire à tous les désirs du Père Abbé et des moines. Cependant le temps pressait ! La 5e armée [américaine] avançait, sur le Mont-Cassin on allait bientôt entendre le tumulte de la bataille. Alors, le malheur pourrait s’abattre en une nuit. Il s’en fallait de beaucoup que tous les trésors transportables fussent mis en sécurité ; le couvent recélait encore toujours d’innombrables objets d’une valeur inestimable.
C’est à cette époque que Schlegel fit la découverte d’un nouveau trésor dont l’existence lui avait été jusqu’alors cachée par l’abbé et les moines.
Il avait remarqué, parmi les réfugiés restés au couvent, deux hommes en uniforme gris portant la tenue des gardiens de musées italiens. Un jour, Schlegel entreprit de questionner les deux hommes et il ne fut pas peu étonné d’apprendre qu’ils étaient réellement gardiens de musée et que c’est même en cette qualité qu’ils étaient en service commandé à Monte Cassino.
Qu’est-ce que cela signifiait ? Le monastère n’était pourtant pas un musée et les moines étaient assez grands garçons pour veiller eux-mêmes sur les trésors de leur abbaye. Mais c’est qu’il s’agissait d’un grand secret qu’ils ne pouvaient pas dévoiler. Et après quelques cigarettes que Schlegel leur glissa adroitement, le secret n’était plus aussi grand ! Les deux hommes commencèrent à lever un coin du voile qui, jusqu’alors, avait recouvert un trésor d’art d’une valeur inestimable : dans le monastère se trouvait une véritable galerie d’art, une collection des plus grands maîtres italiens.
Comment ce trésor était-il arrivé sur la sainte colline ? Schlegel allait apprendre par les deux Italiens et le Père Emmanuel tous les détails de cette découverte sensationnelle. Il s’agissait d’une exposition d’art de Naples.
Les plus importantes galeries italiennes y avaient envoyé des œuvres, cela à une époque où la guerre ne s’était pas encore étendue à la péninsule. Lorsque Naples fut touchée par la première attaque des bombardiers alliés, l’exposition fut emballée et, à la demande du gouvernement italien, envoyée au couvent du Mont-Cassin pour y être conservée. On croyait que là les tableaux seraient en lieu sûr. Il est probable que l’abbé Diamare a gardé le silence sur cette exposition parce qu’il ne se croyait pas en droit de prendre une décision concernant le sort de ces tableaux d’une valeur inouïe. Il est certain qu’il n’avait rien fait pour être désigné comme gardien de ce trésor unique. Cependant, comme l’abbaye percevait de l’État italien une indemnité annuelle pour la conservation des archives — qui, comme on le sait, n’appartenaient plus au couvent depuis 1868, mais à l’État — l’Abbé aurait difficilement pu refuser de se charger de l’exposition napolitaine.
Schlegel décide d’évacuer aussi ce trésor.
Schlegel se posa alors la question : devait-il aussi sauver ces trésors qui, en eux-mêmes, n’avaient rien à voir avec le monastère ?
Le risque que cela comportait n’était pas minime. Des avaries, voire des pertes pouvaient si facilement se produire en cours de transport. Et, en fin de compte, il n’était pas du tout certain que le Mont-Cassin allait être bombardé, rien ne le prouvait. Alors, qu’adviendrait-il si le couvent sortait indemne de la guerre et que par des mesures prématurées on ait amené la perte d’œuvres irremplaçables ?
Malgré tous ses scrupules, Schlegel se décida pour l’évacuation. Mais où transporter les tableaux ? Ils étaient propriété de l’État italien et ne pouvaient donc pas, comme les biens du monastère, être amenés au Vatican. Il était normal d’entrer en pourparlers avec les autorités italiennes, mais à qui pourrait-on s’adresser ? Il y avait à peine quatre semaines que Mussolini venait d’être rétabli dans ses fonctions, son nouvel État manquait encore d’autorité et il avait à cette époque probablement d’autres soucis que de s’occuper de mettre une exposition de tableaux en lieu sûr.
C’est ce qui amena Schlegel à transférer les tableaux sans autre forme de procès dans un château des environs de Spolète. Il y avait là un dépôt de matériel et une garde du détachement de Schlegel. Les œuvres d’art y seraient donc certainement en sécurité. Et les véhicules qui assuraient l’évacuation des archives s’y dirigeaient toujours. Seuls, les véhicules chargés de marchandises appartenant au couvent prenaient la route de Rome, la cité vaticane. Chacune de ces voitures était accompagnée de deux moines ; les transports déposaient leur précieux chargement à Saint-Paul ou à Saint-Anselme, siège du primat des bénédictins. Il se composait en grande partie d’objets du culte d’une immense valeur artistique, dont chacune des pièces représentait un chef-d’œuvre d’orfèvrerie et de nombreux reliquaires qui sont d’une importance capitale pour le monde catholique.
Schlegel avait aussi fait amener à Rome une vieille croix de bois vermoulu qui, à cause de ses dimensions exceptionnelles, ne pouvait être transportée que couchée en diagonale dans le véhicule. Ce vénérable crucifix, dû à l’École de Sienne (XIIe siècle) ne devait à aucun prix se perdre.
Et par la suite, il y eut d’autres objets de valeur : des ornements sacerdotaux d’un art consommé, de vieux livres saints, de précieux tableaux de peinture à l’huile, appartenant en propre au couvent, les tapis rares de l’église, cinq lampadaires d’or du maître-autel et de nombreux objets de prix.
Départ des reliques de saint Benoît.
Confiants, les moines remirent les dépouilles mortelles des abbés cassiniens aux soldats allemands qui allaient les placer en lieu sûr à Rome. Ainsi furent sauvés : les ossements de Desiderius, de Bertharius — celui-ci, tué comme on sait par les Sarrasins — de l’Apollinaire du VIIIe siècle et d’autres saints.
 Un acte solennel allait accompagner le transport des ossements de saint Benoît, le plus grand trésor sacré que recelait le couvent, voire même l’un des plus sacrés du monde catholique. Les reliques furent soigneusement couchées dans un coffre et c’est devant les moines et les soldats émus que le Père Abbé bénit les ossements, avant leur départ pour Rome (voir photo). Le vénérable supérieur qui, maintenant, commençait à se rendre compte que la maison de saint Benoît était perdue, éprouva alors une grande douleur. Trente années durant, le 297e successeur du patriarche avait dirigé en silence le monastère, et maintenant le fondateur de l’Ordre l’avait quitté. Maintenant, sa main protectrice allait se retirer du couvent.
Un acte solennel allait accompagner le transport des ossements de saint Benoît, le plus grand trésor sacré que recelait le couvent, voire même l’un des plus sacrés du monde catholique. Les reliques furent soigneusement couchées dans un coffre et c’est devant les moines et les soldats émus que le Père Abbé bénit les ossements, avant leur départ pour Rome (voir photo). Le vénérable supérieur qui, maintenant, commençait à se rendre compte que la maison de saint Benoît était perdue, éprouva alors une grande douleur. Trente années durant, le 297e successeur du patriarche avait dirigé en silence le monastère, et maintenant le fondateur de l’Ordre l’avait quitté. Maintenant, sa main protectrice allait se retirer du couvent.
Comme au VIe siècle, lorsque les Lombards prirent le monastère d’assaut et le réduisirent en ruine, les moines trouvèrent encore cette fois asile dans la Ville Éternelle. Près de deux douzaines furent accueillis à Saint-Anselme où l’Abbé, primat des bénédictins, Fidelius von Stotzingen, leur accorda l’hospitalité. Le noviciat s’installa à Saint-Paul-Hors-les-Murs et les enfants de chœur trouvèrent refuge au couvent de la Vulgate de Saint-Girolamo.
Les Allemands évacuent les religieuses et les orphelins.
Mais les soldats allemands ne se bornèrent pas à mettre les moines en lieu sûr ; ils assurèrent également le transport de nombreuses religieuses et d’orphelins en toute sécurité sur Rome.
Les Bénédictines de Cassino et deux autres couvents de femmes des environs avaient d’abord cherché refuge au Mont-Cassin avec un grand nombre d’orphelins dont l’éducation incombait aux religieuses. Elles avaient été hébergées par l’Abbé, à proximité du monastère, partiellement dans l’abbaye même, où elles étaient strictement séparées des moines. Pour elles aussi, il s’agissait maintenant d’abandonner la maison de saint Benoît vouée à la mort.
C’est avec plaisir que Schlegel donna suite à la demande du Père Abbé tendant au transport des Bénédictines à Rome. Elles firent le voyage, groupées en convoi. Auparavant, Schlegel avait donné à ses soldats des instructions précises en vue d’éviter tout manque de tact de la part de ses hommes, car de nombreuses religieuses étaient âgées et malades et il fallait leur venir en aide pour les faire monter dans les véhicules. Là aussi, les troupiers allemands furent à la hauteur de leur tâche.
L’une des abbesses n’a pas manqué, après l’arrivée à Rome, d’exprimer à Schlegel ses remerciements en insistant particulièrement sur l’attitude chevaleresque des soldats allemands.
On frôle la catastrophe.
Cependant, l’évacuation des religieuses prit une allure dramatique. Alors que la colonne de véhicules avec les trois couvents de femmes et les orphelins se trouvait prête à partir sur la route devant la Torretta, encadrée des moines restés sur place, des bombardiers alliés s’abattirent sur la ville de Cassino.
L’éclatement des bombes, le sifflement des chasseurs d’escorte, firent perdre aux religieuses toute contenance. Saisies de frayeur, ayant perdu la tête, prises d’une panique indescriptible, elles sautèrent des véhicules et cherchèrent refuge devant le danger menaçant. Leurs cornettes blanches reluisaient au loin dans le soleil automnal, comme si elles voulaient appeler les avions.
Si les chasseurs avaient alors remarqué les véhicules de la Wehrmacht, tout était fini ! Cependant, cet incident irritant ne causa aucun dommage aux personnes. Seule la route en lacets avait été défoncée en plusieurs endroits et le funiculaire montant de la ville avait été détruit. Ses gros câbles d’acier étaient tombés à terre et barraient la route en plusieurs points. Il fallut donc écarter ces obstacles avant de faire partir les religieuses pour Rome.
Dans les premiers jours de novembre, l’opération de sauvetage approchait de sa fin. De l’autre côté, venant du Mont-Cassin, on pouvait déjà entendre le bruit de la bataille. Il était temps de quitter la montagne. Lorsque le Père Abbé eut reçu de Rome la bonne nouvelle de l’arrivée en bon état de conservation des reliques de saint Benoît, il dit à Schlegel :
Vous vous êtes acquis un mérite immortel
Et le bon P. Emmanuel ajouta que le lieutenant-colonel était visiblement l’instrument de Dieu. À chaque instant, Diamare exprimait sa reconnaissance à l’officier allemand et lui demandait comment il pourrait donner à celle-ci une expression tangible. Modeste, Schlegel remercia du geste et demanda à Dom Gregorio de dire seulement une messe pour lui et pour ses soldats.
Un codex de reconnaissance pour Schlegel.
Cette messe, à laquelle participèrent tous les soldats employés au monastère et tous les moines restés sur place, prit la forme d’une cérémonie impressionnante. Le Père Abbé célébra lui-même la messe, visiblement ému, comme s’il pressentait que ce fût là le dernier sacrifice de la messe qu’il lui serait donné d’accomplir dans la magnifique basilique.
À la fin de la messe, le Père Abbé fit signe au lieutenant-colonel Schlegel de venir le rejoindre au maître-autel et lui remit, avec des paroles de cordiale reconnaissance, un manuscrit sur parchemin, copie fidèle des anciens « codex », muni du sceau du Mont-Cassin sur un cordon jaune et rouge. Le texte, débutant par une merveilleuse initiale enluminée, toute en écriture lombarde, a la teneur suivante :
In nomine Domini nostri Jesu Christi – Illustri ac dilecto viro tribuni militum Julio Schlegel – qui servandis monachis rebusque sacri Coenobii Casinensis amico animo, sollerti studio ac labore operam dederit, ex corde gratias agentes, fausta quaeque a Deo suppliciter Casinensis adprecantur.
Monticasini Kal. Nov. MCMXLIII.
Gregorius Diamare.
Episcopus et Abbas Monticasini. [7]
Le parchemin artistique avait été exécuté par le moine peintre Dom Eusèbe.
Un document analogue fut également dédicacé au général Conrath, le dux ferreae legionis ; le Père Abbé y exprimait au général allemand ses remerciements les plus chaleureux pour l’opération de sauvetage de la division Hermann Goering. Le Père Abbé Diamare remit aux plus fidèles auxiliaires de Schlegel un certain nombre de médaillons pour exprimer également la gratitude du couvent envers les simples soldats qui avaient assisté les moines avec tant de tact et de zèle.
Ces hommes n’ont pas seulement préservé de la destruction la collection de livres de renommée mondiale et les archives d’une valeur inestimable, les nombreuses reliques et les objets du culte ; ils n’ont pas seulement arraché à une mort possible des moines, des religieuses et des orphelins, mais ils ont mis en lieu sûr les œuvres de choix de l’exposition d’art napolitaine, entre autres, trois Titien, deux Raphaël, des originaux de Tintoret, Ghirlandajo, Pieter Brueghel, etc. Peu de tableaux de Leonard de Vinci furent conservés à la postérité, les soldats de Schlegel ont sauvé sa « Leda ». Elle a depuis longtemps réintégré son lieu d’origine, Naples. Nous leur devons aussi la conservation de vases et de sculptures de l’antique Pompéi.
Ainsi, ces précieux témoins de la civilisation romaine ont échappé aux bombes du 15 février et purent être conservés pour le trésor culturel du monde.
L’évacuation prend fin, les gens et les trésors artistiques sont sauvés.
 Le 3 novembre vit l’achèvement de l’opération de sauvetage (voir photo).
Le 3 novembre vit l’achèvement de l’opération de sauvetage (voir photo).
Auparavant, Schlegel avait proposé au Père Abbé de l’amener à Rome dans sa voiture de service, Gregorio Diamare avait refusé, lui faisant comprendre qu’il ne pouvait pas abandonner son diocèse au moment du danger[8]. C’est ainsi que l’abbé chargé d’années qui, depuis l’an 1912, présidait aux destinées du Mont-Cassin, demeura avec cinq moines, un prêtre de l’administration diocésaine et cinq frères. Tous sont restés jusqu’au dernier moment et ont survécu à l’enfer du 15 février.
 Pour Schlegel, l’heure des adieux était arrivée. Le 3 novembre, il quitta ces lieux dont la postérité lui est redevable, ayant à ses côtés, dans sa voiture, le vieux prieur et le Père Emmanuel (voir photo). À leur tour, ils se rendaient les derniers à Rome pour y attendre, parmi leurs frères, l’heure qui les rappellerait à nouveau au Mont-Cassin.
Pour Schlegel, l’heure des adieux était arrivée. Le 3 novembre, il quitta ces lieux dont la postérité lui est redevable, ayant à ses côtés, dans sa voiture, le vieux prieur et le Père Emmanuel (voir photo). À leur tour, ils se rendaient les derniers à Rome pour y attendre, parmi leurs frères, l’heure qui les rappellerait à nouveau au Mont-Cassin.
Tandis que sur les hauteurs du Mont-Cassin, on emballait encore fiévreusement des caisses et des cadres, des négociations avaient déjà lieu à Rome entre des représentants du ministère italien de l’Éducation, du Vatican et du commandant du groupe d’armées Sud, au sujet de la remise des objets d’art emmagasinés à Spoleto. Sur proposition du maréchal Kesselring, il fut décidé de transférer les archives et les œuvres de l’exposition d’art napolitaine sur le terrain neutre du Vatican.
Comme par le passé, les Cassiniens devaient assurer, dans les États du Vatican, la conservation des archives en tant qu’experts. Ce n’est que grâce à cette décision obtenue par le maréchal que les trésors culturels et artistiques purent enfin être mis en lieu sûr. C’est à la protection de sa main, qui devait encore si souvent s’étendre sur les sites culturels d’Italie, que l’on doit d’avoir pu mettre définitivement en sécurité les trésors cassiniens et napolitains. Ici, au Vatican, on n’avait pas à craindre de bombes ni de gens qui pourraient faire montre de convoitise pour les œuvres d’art sauvées.
À la mi-novembre, Schlegel reçut de sa division l’ordre de se rendre à Rome pour y fixer, en accord avec l’expert en œuvres d’art de l’état-major du commandant du groupe d’armées Sud, le professeur Evers, les modalités pour la remise au Père Abbé de Saint-Paul. Elle allait avoir lieu le 8 décembre, devant le château Saint-Ange…
Dans la soirée du 7 décembre, des camions de la division Hermann Goering roulaient en direction du château de Spolète. Là, ils furent chargés avec les objets d’art sauvés et arrivèrent dans la matinée du lendemain à Rome. La remise eut lieu en présence du commandant d’armes allemand de Rome, le général Malzer et de hauts dignitaires de la curie et de l’État italien.
L’évêque et le Père Abbé de Saint-Paul, Dom Ildebrando Vanucci, préfet de la Congrégation cassinienne, remercia les autorités allemandes, en particulier le lieutenant-colonel Schlegel, pour le sauvetage des objets d’art.
Ensuite, Schlegel fit décharger les véhicules devant le château Saint-Ange, pour assister ensuite, à Saint-Anselme, à une réception offerte en son honneur par l’Abbé, primat des bénédictins.
De nombreux et savants bénédictins étaient présents. Outre l’Abbé primat Fidelis von Stotzingen, on remarquait l’évêque Hudal, alors recteur de l’Anima, le prieur du Mont-Cassin, dom Gaetano Fornari, le bibliothécaire Dom Mauro, et le Père allemand Emmanuel Munding. Les bénédictins étaient trop heureux d’avoir repris la conservation des archives, reflet unique de la brillante histoire du Mont-Cassin et du monachisme de l’Occident.
[Fin du chapitre 2 du livre Monte Cassino par Rudolf Böhmler].
70 ans après, une mémoire… oublieuse.
Soixante-dix ans plus tard, le souvenir de « ce signalé service rendu non seulement à tout l’ordre (bénédictin) et à l’État, mais à l’humanité tout entière »[9] est pratiquement anéanti. Les discours et les monuments anniversaires de la seconde guerre mondiale ne manquent pas, mais ils ne félicitent que les auteurs du bombardement insensé qui réduisit en cendre un haut lieu de la civilisation chrétienne.
Ils venaient nous dit-on, en libérateurs contre l’oppression et la barbarie nazie, et contre leur « politique de destruction de [notre] culture nationale et de [notre] identité spirituelle » (dixit K. Wojtyla)[10]. Les nations dites chrétiennes et civilisées prétendent faire la morale aux autres et elles ne savent même pas dire merci !
Les crimes commis par les Alliés dans la vallée du Liri.
Mais parlons un peu de cette libération du Mont Cassin et de tout le pays environnant que les croisés de la démocratie prétendent avoir arrachés aux horreurs de la guerre. On nous insinue que cette libération apportait un soulagement général : l’horreur de la guerre tenait surtout, voire entièrement dans la barbarie allemande et la suavité pacifique répandait naturellement ses parfums enivrants sur les pas des chevaliers de la civilisation chrétienne, polonais, marocains, algériens, gorkhas, sikhs, tunisiens, français, anglais et américains.
Comment s’est passée réellement à l’époque la « libération » de la vallée du Liri, nous le lirons dans la correspondance particulière d’un journal belge, qui n’est certainement pas suspect d’indulgence pour les « nazis » :
Le triste sort de la population d’Esperia.
Libre Belgique, 20 décembre 1946, page 4.
 La population italienne a été mise en émoi par une question posée par M. Persico, député de la Constituante, au ministre de l’Intérieur et au haut commissaire de l’Hygiène et de la Santé publique, au sujet des victimes innocentes de la vallée du Liri. A la suite de cette interrogation, des enquêtes ont été menées sur place et de pénibles révélations ont été faites par la presse. Nous en parlons comme d’un document humain qui prouve — si cela était nécessaire — que les épisodes atroces qui se sont vérifiés un peu partout pendant la guerre nous ont reportés aux époques les plus sombres de l’Histoire. La guerre déchaîne parfois chez les combattants les instincts les plus bas, surtout si ces combattants sont des hommes vivant en dehors de la civilisation chrétienne.
La population italienne a été mise en émoi par une question posée par M. Persico, député de la Constituante, au ministre de l’Intérieur et au haut commissaire de l’Hygiène et de la Santé publique, au sujet des victimes innocentes de la vallée du Liri. A la suite de cette interrogation, des enquêtes ont été menées sur place et de pénibles révélations ont été faites par la presse. Nous en parlons comme d’un document humain qui prouve — si cela était nécessaire — que les épisodes atroces qui se sont vérifiés un peu partout pendant la guerre nous ont reportés aux époques les plus sombres de l’Histoire. La guerre déchaîne parfois chez les combattants les instincts les plus bas, surtout si ces combattants sont des hommes vivant en dehors de la civilisation chrétienne.
Ces révélations, désormais du domaine public, ne peuvent plus nuire aux bonnes relations entre la France et l’Italie; d’ailleurs, les populations qui ont souffert un des affronts les plus pénibles de cette guerre ne demandent qu’à guérir et à oublier un épisode dont elles ont honte de parler.
Lorsque le front de bataille s’immobilisa autour de Monte-Cassino, les hommes valides de la vallée du Liri se réfugièrent en grande partie sur les montagnes pour échapper aux rafles des Allemands. Il s’agissait de paysans et de bergers de bonne race qui, avant la guerre, menaient dans leurs villages une vie dure, mais paisible. Les femmes pleines de santé et très belles, dans leurs costumes traditionnels aux couleurs chatoyantes, étaient travailleuses, honnêtes et pieuses. Pendant que les hommes, au maquis, aidaient les Alliés en molestant les troupes nazies, elles supportaient avec courage la misère et la famine dans l’espoir que, avec les Alliés libérateurs, leurs hommes seraient rendus à leur modeste foyer.
Les Alliés arrivèrent le 17 mai 1944 ; mais c’étaient des troupes coloniales, qui n’occupèrent pas les villages de l’endroit en libérateurs mais en soldatesque effrénée. Ce fut un jour de malheur pour les habitants d’Esperia, de Pontecorvo, d’Ausonia, etc., que ce 17 mai.
Pendant quinze jours, les Alliés s’étaient battus avec acharnement pour rompre les lignes de défense allemandes et les officiers des troupes arabes, pour inciter celles-ci au combat, leur promettaient le pillage de la vallée du Liri. On sait ce que cela veut dire. On sait aussi que, selon une vieille tradition, les mercenaires arabes ont droit de proie après le combat.
La première bourgade à subir les violences des Africains fut Esperia, un village montagneux d’environ six mille âmes : la joie de la libération avait innocemment poussé la population restante à aller à la rencontre de ces soldats arabes qui servaient de batteurs d’estrade au gros des troupes alliées. On ne peut pas décrire les scènes de sauvagerie qui se succédèrent à partir de ce moment-là. Toute la population d’Esperia, de 10 à 70 ans, fut à la merci de cette soldatesque qui, armée de mitrailleuses et de bombes à main, lui donnait la chasse, le jour comme la nuit.
On entendait des hurlements et les invocations de ces malheureuses gens qui s’efforçaient de se défendre comme ils pouvaient. Les quelques hommes qui se trouvaient dans le village et qui tâchèrent de s’opposer à ces actes de barbarie furent tués ou blessés. Les officiers français, écœurés des scènes de brutalité qui se passaient autour d’eux, n’osaient pas sortir de leurs refuges. Au curé, qui avait demandé leur intervention en faveur de la population, il fut répondu qu’il leur était impossible de se faire obéir à ces moments-là. Ce curé fut lui-même victime des brutalités arabes et mourut l’année suivante, emportant avec lui le secret de son martyre.
Dans le proche village de Picao, un prêtre parvint à se barricader dans son habitation, dans la cour de laquelle s’étaient réfugiées 150 paysannes avec leurs animaux domestiques, jusqu’à l’arrivée des troupes anglo-américaines. Rien ne put mettre un frein aux actes de sauvagerie de ces forcenés armés qui se prolongèrent pendant deux mois dans tous les villages de la contrée. Quand les nègres américains arrivèrent dans ces localités, ils durent menacer de leurs armes les soldats coloniaux pour les empêcher de continuer leurs exploits qui avaient semé la terreur, la consternation et la honte dans cette zone déjà si éprouvée par les bombardements.
Si le temps efface un pénible souvenir, les plaies du corps, au contraire, ne font que s’aggraver sans des soins médicaux appropriés et une nourriture saine et abondante ; d’où le cri d’alarme de M. Persico et de la presse.
Un officier français, qui commandait des troupes arabes pendant ces jours-là, revenu sur les lieux, a pu constater l’étendue du mal fait par ses anciens soldats et s’en est montré extrêmement affligé.
Le regret de cet officier prouve qu’il y a des actes de guerre que de vieilles nations civilisées ne peuvent pas approuver, parce que rien ne peut les justifier. Il y a des lois morales auxquelles aucun homme de cœur ne peut se soustraire, sans quoi il faudrait désespérer de l’avenir de l’humanité.
[Fin de l’article de la Libre Belgique.]
Soixante-dix ans plus tard, ces lois morales demeurent inchangées et transgressées tous les jours. Ne serait-il pas bientôt temps de faire taire le mensonge, en reconnaissant le mal où il fut ? Hélas, il est dans la nature de l’homme, écrit Tacite [De Vita Iulii Agricolae, chapitre 42], de haïr celui que l’on a offensé. Proprium est humani ingenii odisse quem laeseris. Aujourd’hui il y a mieux à faire que de gémir. Rendons plutôt hommage à la vérité, de crainte que cette parole de la Sainte Écriture ne nous soit appliquée :
Parce qu’ils se sont détournés de la vérité qui les eût délivrés, parce qu’ils se sont tournés vers des fables, je leur enverrai, dit l’Éternel, de puissantes illusions qui leur feront croire au mensonge (Saint Paul)[11].
Annexe : un exemple de cynisme éhonté.
CITE DU VATICAN, Mercredi 19 mai 2004 (ZENIT.org) :
La bataille du Mont-Cassin, est en quelque sorte un symbole de la lutte de la Pologne pour la liberté en Pologne et en Europe, rappelle en substance le pape à l’occasion du 60e anniversaire de cette victoire.
A l’occasion de ses 84 ans, le pape a reçu mardi soir un groupe de Polonais conduit par le Président Aleksander Kwasniewski et son épouse. Mercredi, lors de l’audience, il a reçu un grand nombre ses compatriotes, ainsi qu’un orchestre et un chœur de l’armée polonaise venus pour la célébration de cet anniversaire et aussi pour souhaiter au pape un joyeux anniversaire. Mais dans les paroles du pape aucune allusion à cet événement personnel.
Jean-Paul II a rappelé mardi soir que cette visite correspond au 60e anniversaire de la Bataille du Mont-Cassin, lors de la libération de l’Italie, en 1944. La colline que couronne le fameux monastère bénédictin, mis à mal [ô le bel euphémisme] par les bombardements alliés, n’a pu être reprise aux troupes nazies que par l’intervention courageuse des soldats polonais. Tous les autres assauts avaient été repoussés.
Jean-Paul II rappelait :
L’héroïsme des troupes polonaises commandées par le Général Anders, a percé le front,, permettant aux Alliés de libérer l’Italie et d’engager la déroute de l’occupant nazi.
Le pape faisait allusion au cimetière militaire de Cassino où se côtoient des tombes surmontées de la croix latine, de la croix grecque, de l’étoile de David, du croissant de lune musulman.
Jean-Paul II souligne :
Ces héros reposent là après être tombés ensemble pour la liberté, la nôtre et celle d’autrui
La liberté comprend en soi, non seulement l’amour de sa propre patrie, mais aussi la sollicitude pour l’indépendance politique et spirituelle d’autres nations.
Tous ont ressenti le devoir de s’opposer à tout prix à l’oppression de ces pays et de leurs citoyens, mais aussi à la politique de destruction de leur culture nationale et de leur identité spirituelle.
Ainsi le Pape avertit :
Je dis ceci pour rappeler qu’au long des siècles l’héritage culturel et spirituel de l’Europe s’est formé et a été parfois défendu jusqu’au sacrifice de la vie de ceux qui confessaient la foi dans le Christ, ou de ceux dont la religion se référait à Abraham.
Et cela, joutait-il, est un argument fort dans la discussion sur la forme spirituelle à donner à l’Europe.
Le pape faisait ainsi allusion clairement aux débats sur la constitution européenne en affirmant:
Il semble opportun de rappeler cela dans le contexte des fondements constitutionnels de l’Union Européenne, à laquelle la Pologne vient d’adhérer.
Là encore le pape voit le rôle que peuvent jouer les Polonais :
La Pologne ne saurait oublier cela et elle doit même le rappeler à ceux qui, au nom de la laïcité des sociétés démocratiques, semblent oublier la contribution du christianisme à la construction de leur propre identité.
A propos des « difficultés politiques » que traverse sa patrie, Jean-Paul II a dit espérer qu’elles soient promptement résolues, et ceci de façon à ce que
les plus pauvres, les familles nombreuses, les chômeurs, les malades et les personnes âgées puissent se sentir en sécurité dans leur patrie.
Jean-Paul II a évoqué à nouveau la bataille du Mont-Cassin ce matin place Saint-Pierre en disant :
Cet événement est un sujet de fierté pour plusieurs générations, car il est devenu le symbole des plus hautes valeurs de l’âme polonaise, et avant de tout de sa disponibilité à sacrifier sa vie pour notre liberté et celle d’autrui. Comme l’amour de la patrie devait être grand chez ces jeunes qui ont été jusqu’à verser leur sang sur un sol étranger, dans l’espérance de la libération nationale !
Après la guerre, nous avons tant espéré que cet espoir s’accomplisse. Aujourd’hui, nous pouvons remercier Dieu de cette si grande grâce, d’avoir libéré le peuple polonais, et les jeunes générations doivent s’en souvenir elles aussi.
________________________________________________________________________________
[1] Voy. Rivarol, 11 juin 2004, article Roberto Rotondo intitulé : « Mai 1944 : la destruction de la plus vieille abbaye du monde ». Cet article, paru dans 30Jours (n°3, 2004), est consultable en ligne à l’adresse internet : http://www.30giorni.it/fr/articolo_stampa.asp?id=3536.
[2] « La réception du convoi par le personnel du Saint-Siège a été filmée sur une pellicule que l’auteur a personnellement vue et que l’on ne ressort pas volontiers des armoires mais qui n’a certainement pas disparu d’une maison aussi bien tenue que les archives vaticanes. » (Voy. Pierre Maximin, Une Encyclique Singulière sous le IIIe Reich, V.H.O., 1999, p. 96).
[3] Traduit de l’allemand par Edouard Even et publié par Plon, 1961. Nous en reproduisons le chapitre 2, intitulé : « Le sauvetage des trésors d’art et de culture par les soldats allemands ». « Les éléments de ce chapitre, est-il noté, sont tirés d’une série d’articles publiés par l’initiateur et l’organisateur de l’action de sauvetage, le lieutenant-colonel Jules Schlegel, dans la revue Die österreichische Furche (nos 45-50, 1951). Ces articles ont été mis gracieusement à la disposition de l’auteur, Böhmler. En outre, celui-ci s’est appuyé également sur l’ouvrage de Dom Emmanuel Munding, La chute du Mont Cassin. » La traduction a été légèrement revue.
[4] Voy. Die österreichische Furche, nos 46-51.
[5] Dom Tommaso Leccisotti, o.s.b., Monte Cassino, Bâle, 1949, p. 95.
[6] Lettre de Schlegel à l’auteur.
[7] En français :
» Au nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ, les Cassiniens remercient de tout cœur l’éminent et affectionné commandant Julius Schlegel pour la bienveillance, le zèle dévoué et la peine dont il a usé pour préserver les moines et les biens du vénérable monastère de Cassino et ils adressent à Dieu de ferventes prières en sa faveur. »
Mont-Cassin, 1er novembre 1943
Gregorius Diamare, O.S.B.
Évêque Abbé du Mont-Cassin. »
[8] Le Père Abbé du Mont-Cassin est en même temps évêque du diocèse de Cassino, la Terra Sancti Benedicti.
[9] « Le sauvetage était encore en cours, fin octobre 1943, avant la totale destruction du couvent, quand la communauté exprima sa gratitude à ses bienfaiteurs. Elle leur écrivait notamment : “Bien que notre communauté ne pense pas que les Américains et les Anglais s’en prendront à notre couvent, elle vous présente ses remerciements pour l’aide que vous nous avez apportée. Si jamais le monastère devait malgré tout être détruit, ce serait non seulement à tout notre Ordre entier et à l’État italien, mais à l’humanité tout entière que vous aurez rendu un signalé service. Et le fait que ce soit justement des soldats allemands qui sont les auteurs de cette action nous réjouit grandement.” » (Voy. Deutche National Zeitung, 12 février 1988, cité des mémoires du Père Gereon Goldmann.
[10] Karol Wojtyla (J-P II), 19 mai 2004. Voy. l’article : « La bataille du Mont-Cassin, lutte de la Pologne pour la liberté de l’Europe », Zenit, agence internationale d’information www.zenit.org/french. Voir l’annexe.
[11] « Eo quod caritatem veritatis non receperunt ut salvi fierent. Ideo mittet illis Deus operationem erroris, ut credant mendacio. » (2 Thalass., 2, 10).