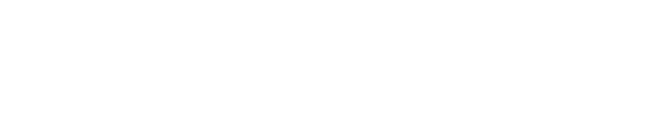Le « pillage » de l’Europe par les nationaux-socialistes :
mythe et réalité
A Nuremberg, les vaincus sont accusés d’avoir pillé l’Europe
L’ouvrage de Rudolf Böhmler rappelle que, pendant la guerre, la propagande alliée a tenté de faire apparaître le sauvetage des trésors artistiques de l’abbaye du Mont Cassin par des membres de la division Hermann Göring comme un acte de pillage (voir l’article »Les oeuvres d’art du Mont Cassin »). Le mensonge étant toutefois trop gros - puisqu’il était aisé de vérifier auprès du Vatican - il ne fut guère exploité dans les semaines suivantes.
H. Göring accusé d’avoir « pillé » l’abbaye du mont Cassin
Mais à Nuremberg, l’Accusation, qui faisait flèche de tout bois, s’intéressa de nouveau à l’affaire du Mont Cassin. Pendant l’instruction, l’accusé H. Göring fut interrogé sur des œuvres d’art qu’il aurait pu recevoir de l’abbaye. Il apparut que l’ancien n° 2 du régime - qui était un fervent amateur d’art - avait hérité d’une statue d’autel !
Pour l’Accusation, il n’en fallait pas plus. Oubliant la gigantesque œuvre de sauvetage allemande, oubliant les remerciements émus des autorités ecclésiastiques, oubliant que sans les membres de la division H. Göring, tous les trésors de l’abbaye auraient disparu pulvérisés par les bombes anglo-américaines, le 20 mars 1946, le procureur général américain Robert Jackson lança à H. Göring :
Je vous demande s’il est vrai qu’une statue d’autel de l’abbaye de Monte-Cassino sur laquelle vous avez porté une appréciation élogieuse vous a été remise ? [TMI, IX, 585]
L’accusé répond
Nullement, décontenancé, l’accusé répondit :
Je suis heureux de pouvoir m’expliquer sur cette question. Après la destruction complète par les bombardements du monastère de Monte-Cassino […] apparut un jour une délégation apportant une statue de saint, sans aucune valeur artistique, comme dernier souvenir du monastère détruit. J’ai remercié ces gens et j’ai montré la statue au conservateur de ma collection qui la considéra également comme sans valeur. Elle est restée dans sa caisse reléguée quelque part [Id.].
Après une courte intervention du Président qui lui demanda de parler plus fort, H. Göring reprit. Il rappela que :
Les trésors de l’abbaye avaient étaient emmenés directement au Vatican et que ceux du musée de Naples avaient également été évacués, non pour être emportés en Allemagne, mais pour être « mis à la disposition du gouvernement italien » (Id.).
L’ancien n° 2 du régime poursuivit ainsi :
Quelques tableaux et statues ont été emmenés à Berlin et là, m’ont été remis. Le même jour, j’en ai donné une liste au Führer et, quelque temps après, je lui ai remis les objets eux-mêmes qui étaient disposés dans mon abri, afin qu’il puisse en discuter avec Mussolini. Je n’ai conservé aucun de ces objets pour ma collection [Id.].
H. Göring termina en indiquant que :
Sans l’action de ses troupes, « les trésors d’art sans prix, entreposés à Monte-Cassino et qui appartenaient au monastère, auraient été irrémédiablement détruits par le fait des bombardements ennemis, c’est-à-dire anglo-américains (Id.).
Comme on pouvait s’y attendre, le Tribunal ne fit aucun commentaire. Le procureur Jackson revint juste sur la valeur de la statue d’autel gardée par l’accusé. Il lui demanda si elle était vraiment « sans valeur véritable » (Id.). L’accusé répondit qu’il en était persuadé, parce qu’il faisait confiance à son expert ; c’est pourquoi il n’avait jamais fait déballer cet objet, s’étant contenté de « dire quelques mots aimables » à ceux qui le lui avaient apporté (Ibid., p. 586).
Le procureur n’insista pas et changea de sujet.
Une accusation déjà lancée en 1919
On aurait toutefois tort de croire qu’à Nuremberg, les vainqueurs n’ont pas accusé le vaincu d’avoir pillé l’Europe.
Bien au contraire. Si un manuel scolaire d’Histoire publié en 1983 pouvait déclarer :
Le pillage des biens juifs et des musées alimente les collections du maréchal Göring et celles de musées du Reich »[1]
C’est parce qu’à Nuremberg, l’Accusation n’a cessé de présenter l’occupation de l’Europe comme une vaste opération de pillage et de destruction économique et culturel.
Cette accusation, notons-le en passant, n’était pas nouvelle. Déjà en 1914-1918, on avait reproché à l’Allemagne d’avoir voulu détruire le patrimoine culturel et scientifique de l’humanité.
Dans son numéro d’avril 1919, ainsi, l’Alliance française avait déclaré :
[…] l’Allemagne a fait la guerre à l’art et à la science. Elle a appauvri, volontairement, le patrimoine artistique et intellectuel de l’humanité, détruit de la beauté et anéanti de l’histoire […]. [Les Allemands] ont détruit sans nécessité ni excuse militaire, par haine et par rage. Ils se sont vengés sur les monuments de la résistance des hommes[2].
Les accusations du Ministère public à Nuremberg
Un avocat général américain parle d’un pillage « unique dans l’Histoire »
En 1945, à Nuremberg, la même propagande réapparut. Le 18 décembre, dans son réquisitoire introductif, l’avocat général américain Robert Storey aborda le sujet. « Oubliant » les bombardements de terreur alliés qui avaient englouti un nombre incalculable d’œuvres d’art et « oubliant » les actions de sauvetage allemandes comme celle du Mont Cassin, il lança :
[…] il faut savoir que l’Europe est un véritable musée contenant presque toute la production artistique et littéraire de deux mille années de civilisation occidentale et qu’elle fut pillée par une horde de vandales expédiant dans le Reich des trésors qui sont notre héritage commun et ne devaient servir qu’à accroître le plaisir et la science des seuls Allemands. Unique dans l’histoire, ce programme de pillage a dépassé l’imagination et constitue un défi à la vraisemblance [TMI, IV, 88].
Le procureur général soviétique parle d’un plan conçu à l’avance
Deux mois plus tard, le procureur général soviétique R. A. Rudenko alla encore plus loin. S’appuyant sur Hermann Rauschning (voir l’article »Hitler m’a dit, un livre mensonger » »), il déclara - sans rire - que les « nazis » ne voulaient même pas se réserver la culture pour eux seuls, mais qu’ils voulaient tout simplement l’anéantir afin de « replonger l’Humanité dans la barbarie » qui régnait au temps des « Huns » et des « Teutons ».
Face au Tribunal, il lança :
Parmi les crimes de guerre commis par les conspirateurs hitlériens, crimes exceptionnellement graves et nombreux […], les crimes contre les valeurs culturelles occupent une place toute spéciale. Dans ces crimes s’est exprimé tout le vandalisme et l’ignominie du fascisme allemand.
Les conspirateurs nazis considéraient toute vie spirituelle et tout humanisme comme des obstacles à la réalisation de leurs inqualifiables desseins contre l’Humanité. Ils éliminaient ces obstacles avec la cruauté qui leur était propre.
Tout en élaborant leurs plans insensés de domination mondiale, tout en déclenchant et en menant une guerre de pillage, les conspirateurs nazis se proposaient aussi d’anéantir la culture. Ils rêvaient de reporter l’Europe à l’époque de sa domination par les Huns et les Teutons et voulaient replonger l’Humanité dans la barbarie.
Il n’est pas nécessaire de rappeler chacune des innombrables déclarations des dirigeants fascistes relatives à la question. Je ne reviendrai que sur une parole de Hitler, citée dans le livre de Rauschning […]. Hitler déclarait :Nous sommes des barbares et nous resterons des barbares. C’est pour nous un titre de gloire.
Par la suite, le procureur soviétique prétendit démontrer que :
Le pillage et la destruction des richesses culturelles des peuples occupés par les Allemands furent conduits suivant des plans minutieusement préparés à l’avance [Ibid., p. 69].
Autrement dit : ce pillage s’inscrivait dans la conspiration générale que les « nazis » avaient mise en place dès 1923, fidèles en cela aux méthodes « boches » de faire la guerre.
Les deux accusés principaux : H. Göring et A. Rosenberg
Sur cette question, les deux principaux accusés furent H. Göring et Alfred Rosenberg.
Le 18 décembre 1945, G. Storey qualifia l’Einsatzstab Rosenberg d’ « organisme chargé d’étudier et de diriger le pillage des trésors artistiques de presque toute l’Europe » (TMI, IV, 88).
Un peu plus tard, l’avocat général français Charles Gerthoffer lança : « L’organe officiel d’exécution des pillages fut principalement l’État-major spécial du ministre Rosenberg » (TMI, VII, 60).
De son côté, le procureur adjoint américain Ralph Albrecht parla du « rôle joué par Göring dans le pillage d’œuvres d’art effectué par l’Einsatzstab Rosenberg » (TMI, IV, 566).
Les documents de l’Accusation
A chaque fois, le principal document cité fut un ordre d’H. Göring en date du 5 novembre 1940 et se rapportant à la France. Il y était question du regroupement au musée du Louvre d’objets d’art ayant appartenu à des juifs. Ces objets devaient être « classés comme suit : »
1°) Objets d’art sur la destination desquels le Führer se réserve de prendre une décision ;
2°) Objet d’art servant à compléter la collection du Reichsmarschall ;
3°) Objets d’art et stocks de livres qui semblent indispensables à la création de la Hohe Schule dont l’utilisation dépend du Reichsleiter Rosenberg.
4°) Objets d’art susceptibles d’être envoyés dans les musées allemands [Doc. PS-141. Voy. TMI, IV, 89].
L’accusation produisit également un ordre signé le même jour par le général W. Keitel et d’après lequel, suite à une proposition d’A. Rosenberg, Hitler avait ordonné de « faire des recherches dans les bibliothèques et archives nationales où se trouvent des documents utiles à l’Allemagne », ainsi que de « fouiller les sièges ecclésiastiques et les loges » (Doc PS-137 ; Ibid., p. 90).
Elle exhiba enfin plusieurs rapports des services d’A. Rosenberg selon lesquels des dizaines de milliers de logements juifs en France et en Hollande avaient été vidés et leur contenu envoyé par trains entiers en Allemagne (voy. plus bas)
Ces pièces donnent en effet l’impression que les Allemands avaient décidé de tout fouiller, bibliothèques, archives, chancelleries, loges et même maisons particulières (de juifs) afin de piller tout ce qui pouvait s’y trouver et qui aurait eu une quelconque valeur pour le Reich.
Les premières saisies furent ordonnées sans plan préconçu
Aucune preuve qu’un plan aurait été conçu à l’avance
Dans un premier temps, toutefois, je souligne que les accusateurs n’ont pas pu produire un seul document qui aurait été antérieur au déclenchement de la guerre.
A ma connaissance, la plus vieille pièce produite sur cette question le fut par le général Rudenko : il s’agit d’une note rédigée le 4 octobre 1939 par Hans Frank à propos d’un éventuel démantèlement du château de Varsovie (doc. URSS-223, voy. TMI, VIII, 69). Par conséquent, la thèse soviétique du « pillage » prévu de longue date s’effondre.
En mai et juin 40, les avions allemands n’ont pas attaqué les monuments du patrimoine français
Ajoutons que si, vraiment, les « nazis » avaient voulu détruire la culture, ils auraient commencé non seulement en Pologne, mais aussi - et surtout - en France aux mois de mai et de juin 1940. Les avions de la Luftwaffe, qui étaient alors maîtres du ciel, auraient bombardé les édifices culturels du pays, et en premier lieu les églises.
Or, comme l’a rappelé (sans être contredit) H. Göring à Nuremberg :
[…] je puis affirmer que j’ai parfois donné des ordres qui n’étaient peut-être pas dans la ligne de mes devoirs purement militaires, car j’ai toujours insisté avec force auprès de mes aviateurs pour qu’en toutes circonstances ils épargnassent les magnifiques cathédrales gothiques des villes françaises et se dispensent de les attaquer, même si des troupes étaient concentrées dans les environs ; et si de telles attaques devaient être effectuées, il fallait utiliser des avions à tir précis tels que les Stukas. Chaque Français qui était alors dans son pays pourra confirmer que ce fut en particulier le cas à Amiens, à Rouen, à Chartres ou en d’autres villes, et que les cathédrales - ces monuments artistiques si précieux et si beaux - furent préservées, et ceci volontairement, contrairement à ce qui s’est passé plus tard en Allemagne. Quelques vitraux de cathédrales furent naturellement cassés par la déflagration des bombes, mais les plus précieux avaient été, Dieu merci, préalablement enlevés. Les maisons situées aux alentours des cathédrales ont été victimes des attaques elles aussi, mais à l’exception - autant que mes souvenirs soient exacts - de la petite cathédrale de Beauvais - la grande avait été épargnée - tous ces trésors d’art ont été préservés [TMI, IX, 354].
Les premières saisies furent décidées dans l’urgence
De façon évidente, les fouilles et les saisies reprochées aux Allemands furent décidées dans l’urgence, après les victoires militaires du Reich, au moment où les pays étaient occupés. C’est d’ailleurs ce qu’A. Rosenberg déclara lors des audiences. Interrogé par son avocat, il dit :
Le Ministère Public a affirmé qu’il se serait agi, en la matière, d’un projet longtemps prémédité de pillage de richesses culturelles des pays étrangers. En réalité, il ne s’agissait pas d’une mesure prévue.
Un de mes collaborateurs, lors de l’entrée des troupes allemandes à Paris, avait accompagné une délégation de presse et constaté à cette occasion que les Parisiens revenaient presque tous en masse à l’exception de la population juive, de telle sorte que les institutions et organisations dépendant de ces gens restaient inactives et que les châteaux et appartements de personnalités importantes restaient également sans occupant.
Il demanda qu’on étudiât les archives et la correspondance de ces organismes. J’en ai informé le Führer et lui ai demandé s’il désirait la réalisation d’une telle suggestion […].
L’ordre du Führer a été promulgué au début de juillet 1940, et comme, à côté des archives, un grand nombre d’objets d’art se trouvaient en danger après leur découverte, le Führer ordonna la mise en lieu sûr de ces objets, et leur transfert dans le Reich [TMI, XI, 475-476].
On en déduit :
1°) Que l’action fut décidée uniquement parce qu’il avait été constaté que certaines familles juives influentes avaient fui l’avance allemande et n’étaient pas revenues chez elles ensuite ;
2°) Qu’au départ, il s’agissait principalement de fouiller les archives privées afin de dévoiler l’action des bellicistes[3].
3°) Qu’après avoir constaté la présence, dans les lieux abandonnés, de nombreuses œuvres d’art, Hitler ordonna leur mise en lieu sûr.
Les propos d’A. Rosenberg sont confirmés par les documents
Certains pourront me répondre que l’accusé mentait pour tenter de se présenter sous un jour favorable. Ils se trompent. A. Rosenberg ne mentait pas :
- L’ordre d’H. Göring en date du 5 novembre 1940 et déjà cité plus haut, faisait explicitement référence à une action de « mise en sûreté » ; il commençait ainsi (je souligne) :
En suivant les instructions données jusqu’ici pour la mise en sûreté par l’administration militaire de Paris et l’Einsatzstab Rosenberg des objets d’art appartenant à des juifs […] les objets d’art amenés au Louvre seront classés comme suit [TMI, IV, 89 et TMI, XXV, 233-234].
- Le 21 février 1946, le procureur soviétique produisit une lettre de Rosenberg à Martin Bormann en date du 23 avril 1941. Son auteur avait écrit :
Pour les objets d’art, il n’en a toujours été question qu’en second lieu. En premier lieu sur l’initiative du Führer, il a été transmis à deux reprises aux territoires occupés de l’Ouest un ordre du chef de l’OKW leur enjoignant d’avoir à mettre à ma disposition, comme matériel de recherche, tout document d’intérêt scientifique ou toutes archives en possession d’organisations hostiles à notre idéologie [doc. PS-071, voy. TMI, VIII, 61].
Signalons encore que le 1er mars 1942, le Führer rédigea un décret dans lequel on lisait :
Son Einsatzstab [celui d’A. Rosenberg] a le droit de fouiller toutes les bibliothèques, archives, loges, tous les établissements culturels des territoires occupés pour y trouver les documents désirés et de réquisitionner ces documents au service de la mission idéologique de la NSDAP [doc. PS-149. Voy. TMI, XXV, 235 et TMI, VIII, 60].
Il n’était donc pas question de piller des œuvres d’art, mais de récolter des documents utiles pour la propagande.
Un aveu du Ministère public français
Cette vérité était si peu contestable qu’à Nuremberg, le Ministère public français fut contraint de l’admettre ; l’avocat général C. Gerthoffer parla de l’État-major spécial de Rosenberg :
dont la première fonction théorique consistait à recueillir le matériel politique qui pouvait et pourrait être exploité dans la lutte contre la juiverie et la franc-maçonnerie, par la Hohe Schule [TMI, VII, 62-3].
Qu’en fut-il du « pillage » entre 1940 et 1945 ?
Durant l’occupation, les musées français n’ont pas été pillés
Je souligne d’ailleurs qu’en France, pays hautement culturel occupé tout ou en partie pendant quatre ans, les musées n’ont été ni pillés, ni détruits, bien au contraire.
Voir un communiqué paru dans Les Nouveaux Temps le 9 mars 1943 et démentant les rumeurs de pillages lancées par la radio anglaise : photo ci-contre.
Interrogé à Nuremberg, H. Göring répondit :
Je n’ai jamais saisi ni jamais fait enlever quoi que ce soit des musées d’État, à l’exception de contrats d’échange passés avec le Louvre, sur la base d’un accord purement volontaire. J’ai changé une statue qui est connue dans l’histoire de l’art sous le nom de La belle Allemande, œuvre de bois sculpté originaire d’Allemagne, contre une autre statue de bois allemande que je possédais déjà avant la guerre depuis plusieurs années, ainsi que deux tableaux ; un tel échange a été effectué de la même façon que ceux que j’avais l’habitude de pratiquer avant la guerre avec d’autres musées.
De plus, j’ai toujours donné des ordres à toutes les autorités pour qu’elles fassent tout leur possible pour préserver les objets d’art des destructions causées par les bombes ou autres faits de guerre. Je me souviens que lorsque les directeurs du musée du Louvre me dirent que la plupart des objets venaient d’être mis en sûreté dans les salles des châteaux dits « de la Loire », je leur répondis que, s’ils estimaient que le développement des attaques aériennes nécessitait un transfert dans des lieux sûrs à déterminer par eux, je donnerais suite à leur requête en leur fournissant les moyens de transport qui leur faisaient défaut [TMI, IX, 354].
Finalement, H. Göring était prêt à refaire en France ce que ses hommes avaient déjà fait au Mont Cassin !
Des œuvres répertoriées en vue de leur classement
La Hohe Schule
Certes, il est incontestable que les Allemands se sont intéressés de près aux patrimoines culturels des pays occupés en Europe. Dans son décret du 5 novembre 1940, qui exigeait le classement des œuvres d’art rassemblées au Louvre, H. Göring avait créé une catégorie intitulée : « Objets d’art et stocks de livres qui semblent indispensables à la création de la Hohe Schule et dont l’utilisation dépend du Reichsleiter Rosenberg » (doc. PS-141).
Bien que devant être instituée après la guerre, les bases de cette « Hohe Schule » avaient été posées au début du conflit. Un décret du 29 janvier 1940 signé A. Hitler déclarait :
La Hohe Schule doit devenir un centre de recherches philosophiques et pédagogiques nationales-socialistes. Ce centre sera institué après la fin de la guerre. J’ordonne que les préparatifs entrepris soient poursuivis par le Reichsleiter Alfred Rosenberg, spécialement en ce qui concerne la fondation d’une bibliothèque. Tous les services du Parti et de l’État sont invités à coopérer avec lui dans l’exécution de cette mission [doc. PS-136. Voy. TMI, IV, 88-89].
Aucun pillage des sculptures à l’Est
Dans son réquisitoire introductif, l’avocat général américain R. Storey parla d’un décret qui prouvait l’arrogance de Hitler[4]. Afin de répondre à l’Accusation soviétique, il cita une phrase du rapport qui précisait :
Dans les territoires occupés de l’Est, l’activité de l’État-major spécial pour la sculpture s’est limité à un recensement des collections publiques, à leur protection et leur prise en charge par les services militaires et civils [TMI, XI, 478-9].
Les Allemands recensaient tout
Quand on connaît la propension allemande à tout répertorier et à établir des catalogues les plus exhaustifs possibles, il n’y a là rien de surprenant.
Je rappelle par exemple que durant la guerre, tous les cas soignés dans les hôpitaux militaires et autres services militaires de l’armée - qu’il se soit agi de soldats allemands, de volontaires étrangers, de prisonniers de guerre ou de civils - furent soigneusement mis en fiche, classés et archivés aux Archives centrales de la médecine militaire, dans d’immenses salles. Des trieuses automatiques permettaient d’établir très rapidement des statistiques (voir photos ci-dessus).
De façon naturelle, ce que les nationaux-socialistes firent en matière de médecine, ils le firent également en matière d’art, recensant dans toute l’Europe occupée. Lors de son interrogatoire, A. Rosenberg cita une ordonnance du 20 août 1941 adressée par le ministre du Reich pour les territoires occupés au Commissaire du Reich Ostler (qui administrait le Gouvernement général).
On lisait :
Je vous demande expressément d’interdire que, sans votre autorisation, des œuvres d’art, quelles qu’elles soient, soient sorties par un quelconque service de votre commissariat » (TMI, XI, 479).
Cette ordonnance concernait également les « richesses culturelles confisquées » ou celles « éventuellement […] mises à la disposition des travaux de l’institut de recherches » ; leur gestion serait déterminée « par une règlementation ultérieure ». Le ministre avait enfin tenu à souligner :
L’administration des musées et bibliothèques restera assurée par l’État, bien que l’État-major spécial ait droit de regard et d’inventaire [Ibid., p. 480].
On le voit : il agissait de recenser et de cataloguer, pas de se comporter en pillards. Ainsi que l’a résumé l’avocat d’A. Rosenberg :
Si l’on pense à l’immense labeur d’inventaire, de classement, de restauration et d’estimation scientifique qui a été fourni et si, enfin, l’on se rend bien compte que tous ces objets précieux furent préservés avec le plus grand soin et supportèrent certainement mieux la guerre que si les autorités allemandes ne s’en étaient pas souciées, je crois que l’ont peut alors, objectivement, parler de tout plutôt que de vandalisme [TMI, XVIII, 110-111].
Les cas des établissements vidés de leur contenu
Certains pourront me répondre qu’en de nombreux endroits, les Allemands ont finalement vidé des musées, des galeries et des bibliothèques, emportant des collections diverses dans le Reich.
Un exemple flagrant, cité à Nuremberg, fut celui de la bibliothèque de l’Institut social d’Amsterdam que les occupants déménagèrent en 1944 (doc. PS-091).
Deux ordonnances de 1942 évoquent la mise en sécurité des œuvres d’art
Mais l’épisode du Mont Cassin doit nous appeler à la prudence ; en temps de guerre, des opérations d’évacuation sont souvent organisées, dont l’objectif est la mise en sécurité, pas le vol. Devant ses juges, A. Rosenberg cita une ordonnance du ministre du Reich pour les territoires occupés. Datée du 7 avril 1942, celle-ci prescrivait :
Dans certains cas exceptionnels, pour prévenir un danger imminent, par exemple écroulement d’immeuble, action ennemie, conséquences des intempéries etc., des mesures immédiates doivent être prises en vue de la mise en sûreté et du transport des objets d’art en lieu sûr [TMI, XI, 480].
Quelques mois plus tard, le 30 septembre 1942, le Haut Commandement de l’Armée de terre informa ses services que l’État-major spécial d’A. Rosenberg s’était vu « accorder le droit de mettre en sécurité […] en particulier les trésors des musées, afin de les préserver de tout dommage ou de la destruction » (Ibid., p. 481).
Des déménagements sont organisés suite aux premiers revers militaires
C’est dans ce cadre qu’à partir de 1943, avec les premiers graves revers militaire du Reich et les zones de combat qui, en conséquence, se rapprochaient, des évacuations furent organisées. Le document PS-1015 rappelait par exemple :
Au cours des évacuation [des territoires de l’Est], quelques centaines des icônes russes les plus précieuses, quelques centaines de tableaux russes des XVIIIe et XIXe siècles, quelques meubles et pièces de mobilier furent mis en sûreté et transportés dans le Reich [Ibid., p. 479].
Accusé, A. Rosenberg contre-attaque
En guise de commentaire, A. Rosenberg déclara :
Je veux seulement indiquer que l’État-major spécial à l’Est n’a pas détourné d’œuvres d’art soviétiques, mais qu’au moment de la retraite, comme les documents ultérieurs le prouveront, il a procédé à des évacuations hors des territoires immédiatement menacés par la guerre sur les arrières de l’armée. Ces œuvres d’art ont alors été réparties et en partie mises en sécurité dans le Reich [Id.].
Peu après, il tint sa promesse et contre-attaqua en se fondant sur les documents produits par le Ministère public soviétique :
Le document PS-161 traite d’un ordre de ramener certaines archives de Lituanie et d’Estonie. Le Ministère public soviétique en a déduit qu’il y avait eu pillage d’œuvres d’art dans ces pays […].
Je me permets de mentionner la date de ce document : 23 août 1944, au moment où les opérations militaires ont atteint ces territoires et exigé la mise à l’abri de ces archives et de ces biens culturels. Tout d’abord ces archives devaient être abritées dans des domaines estoniens, donc rester à l’intérieur du pays malgré les combats. Pour autant que je sache, ultérieurement, quelques-unes de ces archives furent aussi amenées en Allemagne et conservées dans le château de Bavière, à Hochstadt […].
Il y a toute une série de documents PS-035 et certains autres, que le Tribunal a déjà vus et qui traitent du transfert des richesses culturelles hors d’Ukraine. La date de ces documents, 1943, montre également que ces richesses culturelles restèrent dans le pays, conformément aux instructions, jusqu’à cette date et que ce n’est que lorsque les combats le rendirent nécessaire qu’elles furent ramenées.
Le document PS-035, page 3, paragraphe 5, dit textuellement : « La division d’infanterie attache une grande importance à la poursuite de l’évacuation des installations de prix, étant donné que cette zone de combat ne peut en aucun cas être suffisamment protégée par l’Armée. Il faut également compter avec l’entrée prochaine en activité de l’artillerie ». […]. L’évacuation se produisit donc sous les tirs de l’artillerie et ce n’est que plus tard que ces biens furent transférés en Allemagne [TMI, XI, 501-2].
L’accusé A. Seyss-Inquart explique de la même manière le déménagement d’une bibliothèque à Amsterdam
Interrogé plus tard par l’avocat d’Arthur Seyss-Inquart à propos de la bibliothèque de l’Institut social d’Amsterdam, l’accusé déclara :
Nous avons d’abord décidé que cette bibliothèque resterait en Hollande et que les travaux de classement seraient effectués à Amsterdam (ce classement n’était pas fait encore). Il a été effectué au cours des années suivantes. Ce n’est qu’en 1944, lorsque l’invasion eût commencé ou qu’elle était imminente et que les attaques aériennes devenaient de plus en plus intenses dans cette région, qu’une partie en a été transportée en Silésie ; une autre partie n’a pu, à ma connaissance, être évacuée et est restée à Emden, et je crois que la troisième partie n’a pas été enlevée [Ibid., p. 537].
Pourquoi les Allemands ont-ils ramené dans leur pays des œuvres d’art ?
Mais j’entends déjà l’objection :
Certes, on peut comprendre que les Allemands aient déménagé des collections pour les mettre à l’abri. Mais il est difficile de croire qu’il n’y ait pas eu, dans les territoires occupés, suffisamment d’endroits sûrs pour les y entreposer. Dès lors, le transport dans le Reich laisse plutôt croire qu’il s’agissait d’un vol pur et simple.
Des initiatives conformes au Droit international
A cette objection, je réponds que si rien ne prouve l’absence de caches adéquates pour les œuvres d’art en Ukraine, en Lituanie etc., rien n’en prouve non plus l’existence. Et même à supposer qu’il y en ait eu, il est possible que les Allemands leur ait préféré des abris en Allemagne qu’ils estimaient encore plus sûrs pour diverses raisons.
J’ajoute que dans sa plaidoirie, l’avocat d’A. Rosenberg s’est appuyé sur l’œuvre d’un juriste pour démontrer que :
l’occupant [pouvait], conformément au Droit international, avoir le droit et le devoir de transporter dans son pays, en vue de les mettre à l’abri, les objets d’une valeur scientifique ou artistique particulière[5].
Preuve que le législateur avait prévu (et accepté d’avance) le déménagement de collections et leur transport (temporaire) hors du pays occupé.
Le cas des œuvres retrouvées dans des « cachettes »
A cela, l’avocat général français C. Gerthoffer répondit que :
Si beaucoup d’œuvres d’art déménagées par les Allemands avaient effectivement été retrouvées, elles l’avaient été le plus souvent dans des cachettes (TMI, VIII, 78).
Selon lui, ce simple fait attestait que les Allemands avaient volé. L’ineptie d’un tel « argument » apparaît immédiatement : quand on veut protéger des objets contre des bombes pesant jusqu’à une tonne, on ne les met ni dans des remises, ni même dans des caves, mais dans des abris bien plus profond (bunkers, anciennes mines[6]) qui peuvent apparaître comme autant de « planques ».
La mauvaise foi de l’Accusation
Mais il y a plus. Sur ce sujet, l’Accusation a démontré sa mauvaise foi avec le document PS-1109.
Le 21 février 1946 l’avocat général M. Y. Raginsky produisit un rapport allemand du 17 juin 1944. Il y était question de l’ « exportation des richesses culturelles » d’Ukraine. On y apprenait qu’en octobre 1943, « 40 wagons chargés d’objets d’intérêt culturel » sortis d’instituts scientifiques avaient été envoyés dans le Reich à partir de Kiev (TMI, VIII, 92-93). Pour l’Accusation, ce document (qui avait reçu le numéro PS-1109) confirmait le pillage à grande échelle commis par l’Allemagne, et plus particulièrement par les services d’A. Rosenberg.
Curieusement, toutefois, il ne fut pas utilisé lors des audiences et jamais l’accusé principal ne fut appelé à s’expliquer à son propos. Pourquoi ? La raison apparut le 10 juillet 1946. Dans sa plaidoirie, l’avocat d’A. Rosenberg souligna que d’après les termes mêmes du document PS-1109 :
Les instituts scientifiques qui avaient été sauvés devaient être aussitôt ramenés en Ukraine au moment où, comme on l’espérait, les troupes [allemandes] y rentreraient [TMI, XVIII, 108]
L’avocat concluait ainsi :
Lire dans ce texte, vouloir trouver dans un texte aussi clair une intention de pillage, me semble absolument impossible » (Ibid., pp. 108-9).
Pour conclure dans le sens opposé, l’Accusation soviétique avait tout simplement omis le passage relatif au retour espéré des richesses culturelles ukrainiennes envoyées (temporairement) dans le Reich. On ne saurait être plus malhonnête.
Voilà pourquoi je réponds à ceux qui seraient tentés de formuler l’objection ci-dessus :
Si vous voulez me convaincre que les Allemands ont volé, il faut le démontrer positivement et ne pas se contenter de simples suppositions appuyées sur des pièces tronquées. Tant que vous m’opposerez des “il est difficile de croire que” je vous répondrai que le doute doit profiter à l’accusé et je vous citerai le document PS-1109 qui contredit clairement la thèse du pillage ».
A partir de 1943, l’Allemagne se battait pour survivre
A cela, j’ajoute un argument de bon sens : on pourrait à la rigueur comprendre qu’entre 1940 et 1942, à l’heure où l’Allemagne semblait être position de vaincre et de dominer l’Europe, les nationaux-socialistes aient organisé des vols d’œuvres d’art à grande échelle pour préparer la grandeur du futur « Reich de mille ans ».
Mais en 1943 et plus encore en 1944, le Reich se préoccupait surtout de redresser la situation militaire qui devenait chaque jour plus défavorable. Il n’était alors plus question de grandeur, mais de survie.
Les Allemands pensaient que les collections artistiques pourraient servir au moment de conclure la paix
Ici, le partisan de la thèse du pillage sourira de mon ingénuité et me remerciera de lui avoir fourni un nouvel argument : Vous me dites qu’en 1943-1944 le Reich qui déménageait les collections d’œuvres d’art luttait pour sa survie. Parbleu ! tout s’éclaire : Hitler prenait ces collections comme on prend des otages ; il voulait s’en servir pour que la paix espérée soit la moins mauvaise possible. L’avocat général français a Nuremberg a donc eu raison d’affirmer qu’outre le valeur esthétique des objets volés, les nazis ont pris en compte la “valeur d’échange” ; ces collections pillées apparaissaient, dit-il, comme “un gage pouvant, sinon faciliter, du moins servir de moyen de pression dans les négociations du futur traité de paix” (TMI, VII, 72) ».
Ma réponse à cela est claire : il va de soi que, pour les dirigeants du Reich, ces œuvres d’art mises en sécurité pourraient également servir au moment de conclure la paix. Devant ses juges, A. Rosenberg ne l’a pas nié, déclarant :
Ces œuvres d’art constituaient en outre un gage précieux pour des négociations ultérieures (TMI, XI, 481-2).
Dans sa plaidoirie, son avocat confirma :
[Rosenberg] n’a jamais nié que ses collaborateurs et lui espéraient que les tableaux resteraient en Allemagne, peut-être comme compensation ou comme gage pour les négociations de paix (TMI, XVIII, 109).
Un procédé habituel
Mais la recherche et l’utilisation de « moyens de pression » en prévision et pendant des négociations de paix sont choses naturelles. Je rappelle qu’après le 11 novembre 1918, l’Angleterre poursuivit le blocus total de l’Allemagne pour la contraindre à signer le honteux diktat de Versailles.
La paille et la poutre
En outre, je pose la question suivante. Qu’est-ce qui est le plus condamnable : saisir les œuvres de l’ennemi pour avoir un « moyen de pression » au moment de négocier la paix ou détruire impitoyablement les œuvres d’art de l’ennemi dans d’atroces bombardements massifs afin d’obtenir une capitulation sans condition (voir photos de Hambourg et de Nuremberg après bombardement) ?
Pour qui n’est pas aveuglé par la haine ou par le parti pris, la réponse est évidente !
Voilà pourquoi en 1945, les vainqueurs étaient vraiment mal placés pour blâmer le vaincu à propos des œuvres d’art regroupées dans le Reich. Ils étaient mal placés à cause de ce qu’ils avaient fait :
a) En 1918-1919 pour arracher une paix injuste ;
b) En 1943-1945, pour laminer un adversaire au mépris de toutes les lois.
Le cas des biens juifs
Les documents de l’Accusation à Nuremberg
Mais l’antinazi n’a pas épuisé ses arguments :
Jusqu’à présent, vous avez évoqué le cas des richesses culturelles des États. Vous oubliez toutefois que le principal reproche fait aux nazis est d’avoir spolié les juifs, notamment ceux qui vivaient (ou qui s’étaient réfugiés) en France ou en Hollande et qui, en 1940, avaient abandonné en hâte leurs habitations pour fuir l’avance allemande. Non seulement les œuvres d’arts trouvées chez eux furent volées, mais aussi - puisque tous n’étaient pas des riches amateurs d’art - les habitations furent vidées. Leur contenu (mobilier, linge etc.) fut donné à des Allemands.
Au procès de Nuremberg, l’Accusation a produit plusieurs documents accablants qui émanaient des services de l’accusé Rosenberg :
- Le RF-1329 (L-118, pièce 8) selon lequel, en France, plus de 69 619 logements de juifs avaient été pillés, permettant de récupérer plus de 1 million de mètres cube de mobilier, tous ces objets ayant nécessité pour leur transport 26 984 wagons, soit 674 trains ;
- Le RF-1330 (L-118) précisant que dans la seule ville de Paris, 38 000 logements de juifs avaient été vidés ;
- Le RF-1327 (PS-171) qui évoquait l’envoi, le 3 octobre 1942, de 40 000 tonnes de meubles vers le Reich ;
- Le RF-1325 (PS-1772) selon lequel en Hollande, de mars 1942 à juillet 1943, 22 623 logements avaient été vidés, le transport des objets récupérés ayant nécessité 586 péniches et 178 wagons.
Tels sont les chiffres, incontestables. Face à eux, allez-vous prétendre que les nazis n’étaient pas d’affreux pillards ?
Les raisons alléguées par certains nationaux-socialistes pour présenter les saisies comme des rétorsions justifiées
Les préceptes juifs qui permettent de dépouiller les goïm
Dans un premier temps, je ne contesterai pas que, chez certains nationaux-socialistes (y compris, semble-t-il, chez Hitler), la spoliation des juifs était considérée comme justifiée au nom du principe : « œil pour œil » ou « tu quoque » (toi aussi tu le fais).
A Nuremberg, ainsi, l’Accusation française cita le chef de l’État-major d’A. Rosenberg, un certain Utikal, qui avait écrit afin de justifier la saisie des biens juifs :
Les mesures de représailles allemandes contre les juifs ont aussi leur fondement dans le droit des gens. Il y a, dans le droit des gens, un principe reconnu, selon lequel on a le droit d’employer dans la guerre les mêmes conceptions et d’exercer les mêmes représailles, dont l’adversaire a usé en premier. Or, les juifs ont de tout temps, dans leur droit formulé dans le Talmud et le Schulchan Aruch, appliqué ce principe que tous les non juifs doivent être considérés comme du bétail et, par conséquent, sont dépourvus de droits, que la propriété des non juifs doit être traitée comme une chose qui a été abandonnée, c’est-à-dire comme n’ayant pas de maître [doc RF-1321, annexe ; voy. TMI, VII, 70].
Ceux qui adoptaient cette position - et même les autres qui ne prétendaient pas se fonder sur les livres traditionnels juifs - ne se privaient pas de rappeler l’action des juifs dans l’Allemagne (et en Europe), non seulement pendant la guerre[7], mais aussi entre 1919 et 1933 : la façon dont ils avaient profité de la crise des années 20 pour prendre une grande place dans l’économie, acquérant des biens énormes.
A Berlin, sous Hitler, l’Institut pour l’étude de la question juive édita plusieurs brochures sur la question, dont celle, très documentée, de Friedrich Karl Wiebe : L’Allemagne et la question juive[8].
Pour toutes ces personnes, les Allemands ne faisaient finalement que reprendre ce que les juifs avaient acquis illégitimement au cours de l’histoire, et plus particulièrement après la défaite de 1918.
L’Allemagne avait été pillée depuis des siècles
Mais on aurait toutefois tort de croire que cette propagande antijuive traditionnelle fut l’argument unique ou même l’argument principal invoqué par ceux qui saisirent les biens juifs. En Allemagne, ils justifièrent leur action en rappelant tout d’abord les pillages dont les États germaniques avaient été victimes au cours de l’histoire sans jamais obtenir réparation.
A Nuremberg, A. Rosenberg déclara :
Je me souviens que beaucoup d’œuvres d’art qui, jadis, avaient été transférées hors d’Allemagne n’avaient pas été rendues, malgré le traité de 1815, depuis des dizaines d’années (TMI, XI, 477).
Plus tard, son avocat posa cette question de bon sens :
Combien, parmi les œuvres d’art célèbres qui se trouvent dans les galeries les plus célèbres du monde, y ont été amenées par les moyens de la guerre et combien par les moyens pacifiques ? [TMI, XVIII, 107]
La « paix » de 1919 avait permis la spoliation de nombreux Allemands
Mais surtout, ceux qui saisirent les biens juifs invoquèrent la paix de 1919 et les spoliations d’Allemands qu’elle avait permises.
Dans son paragraphe b, l’article 297 du traité de Versailles stipulait en effet que les Puissances alliées et associées pouvaient déposséder les ressortissants allemands vivant sur leurs territoires (donc dans les territoires et les colonies arrachés au vaincu) ; bien que le § c ait prévu des indemnités en cas de dépossession, non seulement celles-ci étaient laissées à l’appréciation de l’État qui dépossédait, mais aussi, le § i contraignait l’Allemagne à indemniser elle-même ses ressortissants dépossédés. Enfin, le § 2 de l’annexe interdisait à l’Allemagne et à ses ressortissants de réclamer ou d’intenter une action en justice suite à une dépossession[9]. La porte était donc laissée ouverte à tous les abus et, fatalement, de très nombreux se produisirent. La valeur des spoliations se compta en milliards de Reichsmark.
A Nuremberg, A. Rosenberg déclara qu’au moment justifier la saisie des biens juifs, il avait :
songé à une mesure qui avait été considérée par les Alliés en 1914-1918 en accord avec la Convention de La Haye. A cette époque, une certaine catégorie de citoyens allemands, plus précisément les Allemands de l’étranger et des territoires allemands occupés, à savoir les colonies, virent leur bien saisis [art. 297, § b] sans qu’ils fussent plus tard indemnisés. Les saisies s’élevaient à 25 milliards de Reichsmark.
Par le Diktat de Versailles, l’Allemagne fut obligée, en plus de cela, de prendre en charge ces Allemands dépossédés et de créer un fonds de secours. Le Ministère public français vient encore une fois à ce Procès de déclarer que le Traité de Versailles avait été conclu sur la base des la Convention de La Haye. Par suite, je conclus que cette mesure dirigée contre une catégorie déterminée de citoyens [les juifs], dans le cadre d’autres mesures militaires, imposées par le circonstance et en respectant par ailleurs la propriété privée, apparaissait justifiée [TMI, XI, 477].
De façon évidente, toutes ces considérations traversèrent également la tête du Führer lorsque, par décret, il ordonna la saisie au profit du Reich des biens juifs trouvés dans des logements abandonnés.
La paille et la poutre
En tant que catholique, et au nom de précepte selon lequel il ne faut pas rendre le mal pour le mal (même si ce mal est décrit comme conforme au Droit international), j’estime que cette saisie des biens juifs est moralement condamnable.
Mais j’affirme également, et avec plus de force encore, qu’en 1945, les Alliés étaient très mal placés pour blâmer le vaincu. Car, sur ce sujet comme sur bien d’autres, ils avaient fait pire, bien pire. Là comme ailleurs, c’est vraiment la paille et la poutre.
Les dirigeants allemands n’ont pas agi mus par l’orgueil ou l’égoïsme
Projets pour des musées destinés à l’éducation du peuple
J’ajoute que, contrairement à une propagande persistante, les Allemands - et notamment H. Göring - n’ont pas agi avec les biens juifs saisis comme des pillards uniquement mus par l’orgueil et des instincts égoïstes. S’ils ont acquis des œuvres d’art, c’était pour créer des musées et, ainsi, continuer leur œuvre d’élévation du peuple par l’accès à la culture (pour plus d’informations sur cette œuvre commencée avant la guerre, voir l’article »L’amélioration des conditions de travail sous Hitler »).
A Nuremberg, H. Göring expliqua sans être contredit :
Ces objets d’art [saisis dans les logements abandonnés] furent tout d’abord amenés au Louvre, puis dans la salle d’exposition appelée je crois, salle du Jeu de Paume. Ce décret concernait des objets d’art qui étaient confisqués comme biens juifs, c’est-à-dire comme biens sans propriétaire puisque ceux-ci avaient quitté le pays. Ce n’est pas moi qui ai donné cet ordre dont j’ignorais le premier mot, mais le Führer. J’en ai pris connaissance lorsque je vins à Paris et j’appris également qu’on avait projeté d’emmener la plupart de ces objets d’art, dans la mesure ou ils constituaient des pièces de musée, au Musée de Linz, dont le Führer projetait l’installation. J’étais personnellement intéressé, je le déclare ouvertement, à ce que toutes ces œuvres ne fussent pas transportées dans le sud de l’Allemagne. Peu de temps auparavant, j’avais décidé, après en avoir informé le ministre des Finances, qu’après la guerre, ou à quelque autre époque qui me semblerait plus propice, je fonderais un musée contenant les objets d’art que j’avais déjà en ma possession avant la guerre et que j’avais acquis soit par achats, soit par cadeaux, soit par héritages, et que je les mettrais à la disposition du peuple allemand. Mon intention était en effet de faire aménager cette galerie, d’après des plans tout à fait différents de ceux qu’on avait réalisés jusqu’ici. Ces plans, qui consistaient à faire de ce musée une annexe de Karinhall dans la grande forêt de Schorfheide où les objets d’art devaient être présentés suivant un ordre historique, étaient terminés mais ne purent être exécutés par suite de la guerre. Les tableaux, les sculptures, les tapisseries, les œuvres d’art devaient être exposés et rassemblés par époques.
Puis, lorsque je vis les objets qui se trouvaient dans la salle du Jeu de Paume et que j’appris que la plus grande partie devait en être expédiée à Linz, que ces objets qui étaient considérés comme pièces de collection devaient servir à des fins d’intérêt secondaire, je reconnais alors que ma passion de collectionneur l’emporta et je me dis que si ces objets étaient confisqués et devaient le rester, autant mieux valait en acquérir une partie pour que je puisse les exposer dans cette galerie d’Allemagne du nord que j’avais l’intention de créer.
Le Führer y consentit à la seule condition qu’il verrait au moins les photographies des objets, que je comptais me procurer. Dans de nombreux cas, il arriva naturellement qu’il désirât se réserver certains objets non pour lui-même mais pour son musée de Linz et j’étais contraint de les lui recéder. Dès le début, cependant, j’ai voulu que l’on procédât à une minutieuse classification, car j’avais l’intention de payer les objets que je désirais installer dans mon futur musée. C’est pourquoi je commis un expert (ce n’était pas un Allemand, mais un Français, quelque professeur dont je ne me rappelle pas le nom et à qui je n’ai jamais adressé la parole) pour estimer ces objets afin de pouvoir apprécier si le prix était trop élevé pour moi, ou si l’objet ne m’intéressait pas, ou si je voulais en payer le prix. C’est de cette façon que furent réglées les premières opérations mais, par la suite, toute l’affaire fut arrêtée en raison des nombreuses sorties et rentrées d’objets : certains objets étaient en effet envoyés au Führer : ils échappaient ainsi à mon contrôle et la question de leur paiement ne pouvait être réglée avant qu’on se fût prononcé sur leur sort.
Dans ce décret, que j’appelais décret préliminaire et que je devais soumettre à l’approbation du Führer, j’insistais sur le fait que c’était moi qui devais effectuer le paiement d’une partie de ces objets et j’ordonnais que ceux qui n’étaient pas des pièces de musée devaient être vendus aux enchères à des amateurs français ou allemands ou à toute personne assistant à la vente. L’argent ainsi recueilli, dans la mesure où il s’agissait d’objets non confisqués mais achetés, devait être versé aux familles des victimes françaises de la guerre. J’ai demandé à plusieurs reprises ou je devais envoyer les fonds et, en collaboration avec les autorités françaises, on décida qu’un compte en banque serait ouvert. On se référait toujours à l’ouverture d’un tel compte. Jusqu’à la fin, une somme d’argent a toujours été disponible dans ma banque […].
En résumé, et pour conclure, je désire affirmer qu’aux termes d’un décret j’ai considéré que ces objets étaient confisqués au profit du Reich. Je me suis donc cru justifié à en acquérir quelques-uns, d’autant plus que — fait que je n’ai caché ni au ministre des Finances du Reich ni à qui que ce soit d’autre — ces objets d’art de valeur devaient s’ajouter à ceux que je possédais déjà pour prendre place dans le musée dont j’ai déjà parlé [TMI, IX, 351-3, voir les pages 351, 352 et 353]
.
Il est d’ailleurs intéressant de noter que l’Accusation française ne chercha même pas à contredire H. Göring lorsqu’il affirma avoir voulu créer un musée pour permettre au peuple d’accéder à la culture. Mais comme il fallait à tout prix noircir l’ancien n° 2 du Régime, l’avocat général français C. Gerthoffer parla de « satisfaction d’un besoin collectif conforme au mythe de la Plus Grande Allemagne »[10].
Ainsi, même le souci d’élever le peuple par la culture devenait le symptôme d’une aspiration (criminelle) à l’hégémonie mondiale.
H. Göring ne s’est pas comporté en pillard
Lors de son réquisitoire introductif, l’Accusation française voulut également démontrer que Göring s’était comporté comme un voyou avec les œuvres d’art confisquées. Il les aurait échangées contre des œuvres qui l’intéressaient beaucoup plus, mais en exerçant une contrainte sur les propriétaires pour qu’ils ne puissent refuser. L’Accusation française produisit ainsi un témoignage écrit - un seul -, celui d’un vendeur de tableaux à Paris, un certain Gustav Rochlitz.
En février 1941, il avait effectué un échange - relativement avantageux - avec un représentant de Göring : deux tableaux anciens contre onze modernes. Le 8 janvier 1946, il déclara qu’on l’avait alors empêché de regarder derrière les tableaux, donc qu’il n’avait pas pu voir qu’il s’agissait d’œuvres saisies chez des juifs ; après s’en être finalement aperçu, il avait protesté, mais en vain, le représentant de Göring s’était borné à le traiter « d’ennemi du peuple ». (doc. RF-1317, voy. TMI, VII, 73-4).
Naturellement, aucune preuve ne venait étayer ces déclarations tardives et opportunes. Tout cela sentait le témoignage donné par un individu soucieux de faire oublier ses « bonnes affaires » réalisées avec l’occupant.
Quoi qu’il en soit, H. Göring n’attendit pas d’être questionné sur ce sujet pour l’aborder. Le 15 mars 1946, il expliqua :
En ce qui concerne les échanges, j’aimerais également tirer cette affaire au clair. Parmi les tableaux confisqués, il y avait quelques toiles modernes que je n’ai ni n’aurais personnellement jamais acceptées, bien qu’ayant entendu dire qu’elles fussent demandées sur le marché français. C’est pourquoi j’ai déclaré, en ce qui me concernait, que l’on pourrait également évaluer ces tableaux, puis se les procurer, de façon à les échanger contre des tableaux de vieux maîtres auxquels je m’intéressais beaucoup plus. Je n’ai jamais exercé aucune pression en ce sens. Je ne m’occupais que de la question de savoir si le prix demandé était trop élevé : si oui, je n’insistais pas mais, comme dans toute affaire d’objets d’art, si l’offre était raisonnable, je m’informais sur l’authenticité de ce qui m’était offert. Il ne s’agissait que d’échanges : en aucun cas je n’ai exercé de pression.
Plus tard, après avoir acquis ces objets, j’en utilisai une partie au même titre que les miens, pour faire des échanges avec des musées. Autrement dit, si quelque musée s’intéressait à un de mes tableaux et si je m’intéressais, pour mon propre musée, à un tableau qu’il possédait, nous procédions à un échange. Les échanges avaient également lieu avec des amateurs étrangers. Ces échanges ne portaient pas uniquement sur les tableaux ou objets d’art ainsi acquis, mais également sur ceux que je m’étais procurés sur le marché en Allemagne, en Italie ou dans d’autres pays, ou sur ceux qui étaient déjà en ma possession.
Je voudrais ajouter ici que, indépendamment de ces acquisitions - et je fais allusion à la salle du Jeu de Paume où ces objets confisqués étaient entreposés - je m’étais naturellement procuré des œuvres d’art sur le marché, en France comme dans d’autres pays, avant et après la guerre, ou plutôt pendant la guerre. Je pourrais ajouter que d’habitude, lorsque j’allais à Rome, à Florence, à Paris ou en Hollande, je recevais en très peu de temps, comme si les gens s’attendaient à ma venue, une série d’offres écrites provenant d’amateurs d’art et de simples particuliers. Et bien que la plupart de ces objets ne fussent pas authentiques, ils étaient cependant intéressants et de bonne qualité et j’en acquis un bon nombre sur le marché libre Au début, j’ai eu quantité d’offres émanant de particuliers. J’aimerais souligner que, particulièrement à Paris, j’ai souvent été abusé. Dès que l’on apprenait que des objets d’art m’étaient destinés, les prix en étaient majorés de 50 à 100 % [TMI, IX, 353].
C’est clair : si l’on peut reprocher à H. Göring d’avoir acquis des œuvres d’art confisquées à des juifs, on ne peut l’accuser se s’être ensuite comporté comme un voyou.
Les cas des habitations juives vidées de leur mobilier
L’Allemagne se portait au secours de ses sinistrés
Reste maintenant à évoquer le cas des dizaines de milliers d’habitations juives vidées de leur mobilier.
L’observateur superficiel y verra naturellement une razzia, une action qui lui paraîtra impossible à justifier. Mais l’étude plus attentive des pièces produites par l’Accusation française se révèle capitale. Dans le document RF-1327, ainsi, juste après la mention des « 40 000 tonnes de meubles envoyés vers le Reich », on lit :
Étant donné qu’on a reconnu que les besoins des sinistrés du Reich devaient avoir la préférence sur les besoins de l’Est, le ministère du Reich en a mis une grande part, plus de 19 500 tonnes, à la disposition des sinistrés [TMI, VII, 71].
Il apparaît donc que la saisie des biens trouvés dans les habitations juives vacantes était due à un état de nécessité : nécessité à l’Est, mais aussi - et surtout par la suite - nécessité au sein même du Reich du fait des bombardements alliés qui laissaient de multiples sans-abris.
(pour plus d’informations sur les bombardements alliés, voir l’article »Les « bombardements de terreur » alliés sur l’Allemagne »)
A. Rosenberg confirme
Lors des audiences, A. Rosenberg confirma. Invité à s’expliquer, il déclara :
Le document PS-001 contient dans son début une information selon laquelle à l’Est les conditions de logement constatées étaient si terribles que j’avais posé la question de savoir si l’on ne pourrait pas disposer en France des appartements inoccupés des juifs ainsi que de leur mobilier. Cette suggestion fut consacrée par un décret du chef de la Chancellerie du Reich rendu le 30 septembre 1941 sur l’ordre du Führer.
Du fait des bombardements de plus en plus intenses de l’Allemagne, j’ai pensé qu’il ne serait plus possible de réaliser ces mesures et j’ai alors proposé de mettre ces installations comme aide d’urgence à la disposition des victimes des bombardements sur l’Allemagne dont le nombre s’élevait certaines nuits à plus de 100 000.
Dans le rapport du livre de documents français, il est mentionné au septième paragraphe, comment les confiscations étaient réalisées. Les appartements abandonnés étaient mis sous scellés pendant une longue période dans l’hypothèse de contestations éventuelles et ce n’est qu’après un certain temps qu’on transportait les meubles en Allemagne. Je sais qu’indubitablement cette mesure représente une intervention caractérisée dans le domaine de la propriété privée, mais là aussi, songez à mes considérations antérieures ; j’avais pesé le pour et le contre et en fin de compte songé aux millions d’Allemands sans abri.
J’insiste sur le fait qu’aux fins d’information précise j’avais fait relever dans un grand livre les logements, les noms de leurs propriétaires et l’essentiel du mobilier comme base d’éventuelles négociations pour l’avenir.
En Allemagne, on a procédé de la façon suivante : les sinistrés recevaient ce mobilier et ces objets de ménage contre paiement, et ces livraisons venaient en déduction des dommages que leur accordait l’État. Les paiements ainsi effectués étaient versés au ministère des Finances à un fonds spécial [TMI, XI, 482-483].
Quand on lit ces explications, l’accusation de vol organisé s’effondre. Car outre le fait qu’A. Rosenberg ne s’est pas comporté comme un pillard (mise sous scellé préalable du logement, enregistrement du nom du propriétaire des meubles enlevés), il n’y a pas vol lorsque celui qui soustrait sans violence agit pour répondre à un état de nécessité présent.
La plaidoirie de l’avocat
Dans sa brillante plaidoirie, l’avocat de l’accusé l’a rappelé, déclarant :
On a encore reproché particulièrement à Rosenberg le pillage de mobilier ; il a, dit-on, vidé de leur contenu 69 000 demeures juives, dont 38 000 à Paris, pour l’envoyer en Allemagne. Incontestablement, ces mesures furent prises en faveur des sinistrés des bombardements aériens ; dans les villes détruites par la guerre aérienne, de nouvelles habitations furent aménagées pour les sans-abri […]. La question de la légalité des réquisitions en général est essentielle ; […] dans ce cas précis, la justification de la nécessité n’est-elle pas évidente ? Les bombardements aériens n’ont-ils pas provoqué en Allemagne une extrême misère générale ? On pourrait objecter que l’on pouvait faire échec à la misère par une capitulation sans conditions. A mon avis, il n’est pas possible d’opposer aux arguments de l’accusé la possibilité d’une capitulation sans conditions, le sacrifice de sa propre existence ou l’indépendance du Reich et de ses intérêts personnels. La réquisition de la propriété privée ennemie était l’application d’un droit de réquisition dépassant les dispositions de lois de la guerre et justifié par la nécessité. J’ose affirmer que ces réquisitions mobilières, étant donné les dévastations commises par les bombardements sur l’Allemagne, ne contrevenaient pas « aux usages entre peuples civilisés », « aux lois de l’humanité » et « aux exigences de la conscience collective » (clause de Martens dans le préambule de l’accord relatif sur les lois et coutumes de la guerre sur terre, cf. Scholz, p. 173) [TMI, XVIII, 111].
Une action conforme à la morale chrétienne
J’ajoute que ces développements juridiques sont conformes à la morale chrétienne. Dans sa Somme théologique, Saint Thomas d’Aquin pose la question :
Peut-on voler pour cause de nécessité ?»
Il y répond positivement au motif que :
Dans un cas de nécessité […] toutes choses sont communes : il n’y a donc pas de péché, dans un cas semblable, à prendre la chose d’un autre, puisque la nécessité en fait en bien commun[11].
Plus bas, l’auteur cite Saint Ambroise qui avait écrit :
Le pain que vous tenez caché appartient à ceux qui ont faim ; le vêtement suspendu à votre garde-robe appartient à ceux qui sont nus ; l’argent que vous enfouissez dans la terre, c’est le rachat des captifs et le soulagement des malheureux [Id.].
Paraphrasant Saint Ambroise, je dis :
Le mobilier des appartements abandonnés pas les juifs appartenait aux civils allemands victimes des bombardements de terreur.
Conclusion
Depuis 1945, une propagande insistante présente les nationaux-socialistes comme une horde de vandales qui auraient profité de leurs victoires militaires pour piller l’Europe occupée, volant les biens culturels, dévalisant les musées et vidant les logements des juifs. A Nuremberg, de nombreux documents furent présentés, qui paraissaient démontrer cette thèse.
Mais les explications des deux principaux accusés permettent de rétablir la vérité. Certes, il est indéniable que les nationaux-socialistes ont saisi et se sont appropriés des œuvres d’art trouvées chez des juifs qui avaient fui dans la précipitation. Quelles que soient les justifications avancées (les juifs ont fait pareil, nos compatriotes avaient été victimes des mêmes procédés en 1919, ces biens avaient été acquis illégitimement), cet acte est moralement condamnable, car c’est un vol pur et simple.
Toutefois, la vertu de justice oblige à souligner que les principaux dirigeants allemands, Hitler et Göring en tête, n’ont pas agi par pur égoïsme. Non, ils voulaient créer des musées pour que le peuple accède à la culture.
Naturellement, cela ne rend pas l’action bonne pour autant (car la fin ne justifie pas les moyens et une bonne fin ne change pas le caractère d’une action intrinsèquement mauvaise), mais cela permet de repousser l’accusation selon laquelle les « nazis » auraient volé parce qu’ils étaient des brutes égoïstes et barbares.
En revanche, la saisie et l’envoi en Allemagne de tonnes de mobilier juif sont parfaitement justifiables, car le Reich agissait alors sous l’emprise de la nécessité urgente. Il fallait secourir les victimes des bombardements de terreur alliés sur l’Allemagne, bombardements perpétrés en violation de toutes les lois morales.
Enfin, pour être équitablement jugé, le déménagement des biens culturels trouvés à l’étranger, leur transport au sein du Reich et leur entrepôt dans des « cachettes » doit être remis dans le contexte : un guerre cruelle dans laquelle le vaincu a été contraint de capituler sans conditions. C’est la guerre avec ses dévastations inévitables qui a rendu obligatoire le déménagement de nombreux biens culturels afin de les mettre en sûreté ; ce sont les bombardements alliés cruels qui ont nécessité leur entrepôt dans des « cachettes » (bunkers, mines désaffectées) ; c’est une capitulation sans conditions avec invasion totale du territoire qui a entraîné la découvertes de ces collections mises à l’abri, comme on découvre le butin d’un voleur.
Ainsi a-t-on pu présenter le vaincu comme un vulgaire pillard. Mais il est bien évident que si, comme en 1918, la guerre s’était achevée avec des négociations, ces collections auraient réapparu tout naturellement, soit pour être rendues, soit pour servir comme gage.
Les nationaux-socialistes ont certes mal agi en saisissant des œuvres d’art trouvées chez des juifs, mais pour le reste - qui représente l’immense majorité -, ils n’ont été ni des voleurs, ni des pillards. Ils ont respecté autant que possible la propriété privée, les édifices religieux et les autres centres culturels. Quand ils ne l’ont pas fait, ils ont agi sous l’emprise de la nécessité urgente, parce que c’était la guerre et parce que les Alliés ne respectaient pas les lois de la guerre.
Et malgré cela, en matière d’art, ils ont accompli un travail colossal de classement, de restauration et de protection. Ils l’ont accompli pendant que les Anglo-américains, eux, déversaient des centaines de tonnes de bombes incendiaires sur les villes, engloutissant des centaines de milliers de femmes et d’enfants ainsi que des trésors culturels irremplaçables.
Ce sont les Alliés qui ont détruit Monte Cassino, ce sont les Alliés qui ont détruit Dresde, ce sont les Alliés qui ont détruit Tokyo. Les Huns modernes, c’était eux ! Pour s’en convaincre, il suffit de constater comment, soixante ans après leur victoire, la télévision, qui aurait pu être un magnifique véhicule de la culture, abêtit les masses et véhicule le vulgaire, le laid.
La société libérale triomphante tue la vraie culture, celle que défendaient les nationaux-socialistes. Il n’y a là rien d’étonnant car cette société laïque commence par tuer l’âme.
_________________________________________________________________
[1] Voy. Histoire. Terminales (éd Scodel, 1983) p. 47. Cette phrase se trouve dans le chapitre relatif à l’occupation de la France. Mais elle est très souvent de portée générale.
[2] Voy. l’Alliance française, livraison d’avril 1919, article intitulé : « Un explication s’impose ».
[3] Face aux juges, d’ailleurs, A. Rosenberg précisa : « Il est facilement compréhensible, je crois, que nous ayons pu trouver de l’intérêt à chercher à savoir quelles étaient, au point de vue historique, les différentes organisations qui avaient participé à une action que l’on considère ici comme ayant mis la paix en danger au cours des dernières années ou décades, et à savoir d’autre part combien de personnalités y avaient participé » (Ibid., p. 477. Notons qu’en 1871, les Allemands avaient saisi les papiers de l’ancien ministre Rouher. Le Traité de Versailles en ordonna la restitution [art. 245].).
[4] « [Le décret] est signé par Adolf Hitler et l’on y reconnaît bien sa manière arrogante » (TMI, IV, 89).] et qui « déclencha sur tout le continent l’exécution de ce vaste programme de confiscation des trésors artistiques » (TMI, IV, 88-9). Mais A. Rosenberg contesta cette interprétation. S’appuyant sur un rapport d’activité de ses services pour les années 1940-1944 - rapport également saisi par les vainqueurs et enregistré sous la cote PS-1015 - il souligna que ses hommes ne s’étaient pas comportés comme une horde de pillards ; ils avaient eu pour mission de recenser les œuvres d’art, d’en déterminer minutieusement l’origine, de les faire restaurer le cas échéant et de prendre des photos « pour établir un catalogue des plus consciencieux » [« dans le rapport allant de 1940 à 1944, page 2, on a indiqué que l’origine de ces œuvres était déterminée minutieusement ; page 3, que l’on avait procédé à la prise de photos pour établir un catalogue scientifique des plus consciencieux, que des ateliers avaient été installés afin de restaurer les œuvres d’art avant de les envoyer à leur lieu de destination » (TMI, XI, 478).
[5] TMI, XVIII, 108. L’avocat se référait à l’ouvrage de Scholz, La propriété privée en territoire ennemi occupé et non occupé, Berlin, 1919, pp. 36 et 37.
[6] C’est ainsi que certains objets d’art pris en France dans des propriétés juives abandonnées par leurs propriétaires furent envoyés tout d’abord dans les châteaux de Neuschwanstein, puis, suite aux bombardements aériens, dans une mine autrichienne désaffectée (TMI, XVIII, 109).
[7] A partir de 1918, certains Allemands accusèrent les juifs d’avoir contribué à l’effondrement du Reich. Le 5 août 1919, la Deutsche Zeitung fit paraître un entrefilet annonçant l’organisation d’un concours un peu particulier : trois prix devaient être attribués aux trois meilleurs projets de « prospectus destiné à être répandu et dans lequel la funeste participation des juifs à l’effondrement de l’Allemagne […] soit mise en relief en termes susceptibles d’être aisément compris par la généralité » (Voy. La Documentation Catholique, 1919, t. II, p. 318, col. A, note).
[8] J’ai cité les principaux passages de cette brochure dans mon ouvrage : Julius Streicher à Nuremberg (auto-édité, 2001), pp. 62-68.
[9] Voy. le Traité de Versailles, partie X (« clauses économiques »), section IV (Biens, droits et intérêts), art. 297 et annexe.
[10] TMI, VII, 72 ; notons que l’expression la « Plus Grande Allemagne » n’a jamais été utilisée par les dirigeants allemands.
[11] Voy. Saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, II-II, question LXVI, article 7.