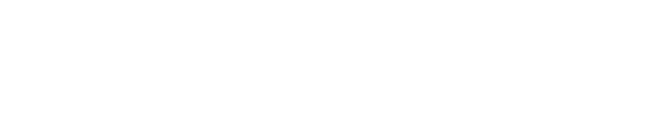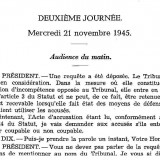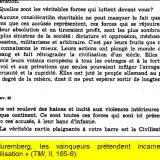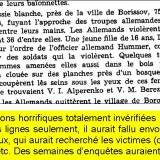Ce que fut le procès de Nuremberg
Des renards pour juger la poule
Si, en 1943, les Alliés avaient décidé qu’une fois les hostilités terminées, un tribunal neutre serait chargé de juger impartialement les différentes parties en présence, chacune d’entre elles étant invitée à déposer librement ses documents sur la table, le projet aurait pu être conforme à l’idéal de Justice.
Mais il n’en fut pas ainsi.
Bien que l’Accord de Londres sur la formation d’un Tribunal Militaire International ait été signé par vingt-trois pays appartenant aux Nations Unies - dont l’Inde, l’Ethiopie, Haïti, le Paraguay - le Statut de ce tribunal prévoyait que les quatre juges seraient désignés par les quatre « Puissances signataires » à la date du 8 août 1945, c’est-à-dire par les USA, l’Angleterre, l’URSS et la France[1].
Et sans surprise, chacune d’entre elles envoya siéger l’un de ses ressortissants : les USA choisirent l’Américain Francis Biddle, l’Angleterre l’Anglais Lord Lawrence (qui sera fait Président du tribunal), la France le Français Henry Donnedieu de Vabres et l’URSS le général soviétique I. T. Nikitchenko.
Oublié, donc, le proverbe anglais selon lequel : « Le renard doit être récusé dans le jury qui juge la poule » ; au terme d’une terrible guerre, le vainqueur allait juger le vaincu avec un droit et un tribunal nouveaux, respectivement créés et composés sur mesure pour l’occasion.
En contradiction avec les usages
Face à ce déni de justice, le 19 novembre 1945, la Défense des accusés à Nuremberg présenta une requête qui se terminait ainsi :
[…] les avocats considèrent que leur devoir de mettre en lumière une autre particularité de ce Procès qui s’écarte des principes communément reconnus par la jurisprudence moderne : les juges ont été exclusivement désignés par les États ayant formé l’un des partis belligérants. Celui-ci est tout en un : créateur du Statut du Tribunal et des règles de droit, procureur et juge. La conviction juridique commune voulait qu’il n’en fût pas ainsi. De même, les États-Unis d’Amérique, et tant que champions de l’institution d’une juridiction et d’un arbitrage internationaux, ont toujours réclamé que des neutres, amenés par des représentants des parties en cause, occupassent le siège des juges. Ce principe a été réalisé d’une façon exemplaire par la Cour permanente de Justice Internationale de la Haye.
En considération des difficultés soulevées par la complexité de ces questions de droit, la Défense dépose la requête :
Que le Tribunal pourrait puiser dans les avis émanant des spécialistes universellement réputés en matière de droit international les bases juridiques de ce Procès fondé par le Statut du Tribunal [TMI, I, 180].
L’argumentation de la Défense était inattaquable : en 1840, déjà, dans son ouvrage intitulé : Saggio teoritico di Dritto Naturale, Taparelli d’Azeglio avait écrit :
On nous demandera peut-être comment on pourra reconnaître la vérité, l’évidence du dommage et du droit, quand l’une des deux nations affirme ce que l’autre nie, et que l’affirmation et la négation semblent fondées sur un droit égal : nous pouvons répondre que c’est précisément l’égalité des parties qui rend l’arbitrage nécessaire ; les parties sont obligées pour vider leur querelle de recourir à des juges impartiaux qui pourront donner une décision équitable. Cette obligation confère à la société neutre une certaine supériorité de droit et la constitue presque juge naturel des parties[2].
En 1856, le traité de Paris avait posé les bases de la « médiation internationale » (art. 8), c’est-à-dire du recours à des tiers pour résoudre des litiges entre puissances[3].
Dans les années suivantes, un tribunal arbitral siégeant à Genève avait vu le jour, qui était parvenu à résoudre pacifiquement l’épineuse question de l’Alabama dans laquelle l’Angleterre était partie. En 1899, le principe des bons offices prodigués par des tiers avait été rappelé et une Cour permanente d’arbitrage fondée, qui allait siéger à La Haye[4]. Sept ans plus tard, l’existence de cette Cour avait été réaffirmée et ses statuts modifiés afin de les rendre plus efficaces[5].
A l’époque, certes, les personnes choisies pour trancher n’étaient pas forcément des neutres. En 1879, ainsi, la Cour de cassation française avait été établie comme tribunal arbitral dans un différent entre le gouvernement français et celui du Nicaragua[6]. Mais les arbitres - et les règles de l’arbitrage - devaient être alors acceptés par toutes les parties en présence. Il n’était donc nullement question qu’une Puissance imposât ses juges - et son tribunal - à une autre.
Dans les années qui suivirent, en outre, la préférence pour des médiateurs neutres fut soulignée. Fin 1932, un avant-projet de convention instituant un « organe mondiale de conciliation » fut publié sous les auspices de la fondation Carnegie.
L’article 65 stipulait :
Les ressortissants des Parties en litige ne peuvent, en aucun cas, faire partie de l’organe conciliateur[7].
Un Tribunal déclaré irrécusable
La Défense à Nuremberg avait donc raison de souligner que le procès des hauts dignitaires nationaux-socialistes « s’écart[ait] des principes communément reconnus » en droit international. Finalement, la démarche des avocats était claire : en demandant au Tribunal de s’interroger sur « les bases juridiques de ce Procès », ils récusaient l’institution mise en place par les vainqueurs au motif que le renard ne pouvait prétendre juger la poule.
Que répondit la Cour sur le fond ? Rien, car les vainqueurs avaient pris les devants. Prévoyant que les vaincus refuseraient une telle mascarade judiciaire,
Dès le Ier siècle avant J.-C., Publilius Syrus avait écrit :
Quand l’accusateur est aussi juge, c’est le triomphe de la force et non de la loi
ils avaient inséré dans le Statut du TMI un article 3 qui précisait :
Ni le Tribunal, ni ses membres, ni leurs suppléants ne pourront être récusés par le Ministère public, par les accusés ou par les défenseurs [TMI, I, 11].
En conséquence, le 21 novembre 1945 à l’ouverture de l’audience, le président du Tribunal se contenta de dire :
LE PRÉSIDENT :
Une requête a été déposée. Le Tribunal l’a prise en considération. Dans la mesure où elle constitue une exception d’incompétence opposée au Tribunal, elle entre en conflit avec l’article 3 du Statut et ne peut, de ce fait, être retenue [TMI, II, 103].
Ce fut tout, et les débats - biaisés - purent commencer.
R. Jackson révèle le véritable objectif du procès
Dès le début, le procureur général américain Robert Jackson révéla le véritable objectif du « procès ». Le 21 novembre 1945, il lança :
La véritable partie plaignante à votre barre est la Civilisation [TMI, II, 166].
Les crimes que nous cherchons à condamner et à punir ont été si prémédités, si néfastes et si dévastateurs que la Civilisation ne peut tolérer qu’on les ignore, car elle ne pourrait survivre à leur répétition […].
Au banc des accusés sont assis une vingtaine d’homme déchus […]. Ce sont les symboles d’un nationalisme et d’un militarisme farouches, d’intrigues et de guerres qui ont jeté la confusion en Europe, génération après génération, écrasant ses hommes, détruisant ses foyers et appauvrissant sa vie [TMI, II, 107].Aucune considération charitable ne peut masquer le fait que les forces que ces accusés représentent […] sont les plus sombres et les plus sinistres de la société : dictature et oppression, méchanceté et passion, militarisme et arbitraire. C’est par leurs fruits que nous les connaissons le mieux. Leurs actions ont plongé le monde dans le sang et fait rétrograder la civilisation d’un siècle. Elles ont soumis leurs voisins européens à tous les outrages et à la torture, au vol et aux privations que seules pouvaient infliger l’arrogance, la cruauté et la cupidité [TMI, II, 165].
La Civilisation ne peut pas admettre de compromis avec les tendances sociales qui verraient leurs forces se renouveler si nous traitions d’une manière équivoque ou indécise ces hommes en qui ces forces survivent encore temporairement [TMI, II, 107].
Procès ? Non, mise à mort du vaincu
On ne pouvait être plus clair : les vainqueurs s’étant autoproclamés champions de la Civilisation face à la Barbarie, leur mission était de tuer les barbares afin d’en délivrer le monde. Dès lors, ce « procès » n’était rien d’autre que le dernier acte d’une guerre à mort. Cette vérité, R. Jackson l’exposa également avec franchise lorsque, le 26 juillet 1946 (trois jours seulement avant le discours lénifiant du procureur français !), il expliqua :
L’Allemagne s’est rendue sans conditions, mais aucun traité de paix n’a été signé ou décidé. Les Alliés sont encore techniquement en état de guerre contre l’Allemagne, quoique les institutions politiques et militaires de l’ennemi aient disparu. En tant que Tribunal Militaire, nous poursuivons l’effort de guerre des nations alliées [TMI, XIX, 415].
Cinq mois auparavant, le procureur général soviétique R.A. Rudenko avait été encore plus net. Visiblement énervé par certains arguments de la Défense, il s’était écrié :
Notre devoir est de n’épargner aucun effort pour écraser le système criminel qui fut dirigé par les organisations fascistes contre l’Humanité [TMI, VIII, 472].
Bref, Nuremberg n’était rien d’autre que la mise à mort publique du vaincu, un peu comme, dans l’antiquité, le chef malheureux était égorgé après le combat. A l’époque, cependant, le vainqueur ne prétendait pas agir au nom de la Civilisation. Le perdant était éliminé, point final.
Mais vingt siècles de Civilisation et la prétention d’agir pour elle ne permettait pas un assassinat si brutal. Il fallait y « mettre des formes ». Telle fut la raison profonde du « procès » de Nuremberg.
Quand on sait cela, l’article 18a du Statut du TMI s’éclaire :
Limiter strictement le procès à un examen rapide des questions soulevées par les charges (TMI, I, 16) signifiait qu’il fallait faire apparaître le vaincu comme un barbare, sans entrer dans des considérations susceptibles de modifier cette vision et afin de pouvoir l’exécuter le plus rapidement possible en y mettant les formes.
Voilà d’ailleurs pourquoi le 6 mars 1946, répondant à l’avocat de l’amiral Raeder qui voulait faire venir plusieurs témoins, le Président déclara :
Comme je vous l’ai déjà dit, il y a 20 ou 21 accusés sur les bancs des accusés et nous devons faire ce Procès le plus rapidement possible. Nous ne pouvons donc pas leur permettre d’appeler autant de témoins qu’ils veulent [TMI, VIII, 571].
Une instruction menée uniquement à charge
La première conséquence fut une instruction uniquement menée à charge, afin de faire apparaître les vaincus comme d’horribles barbares. Les Alliés qui avaient saisi les archives allemandes les survolèrent rapidement pour en extraire les documents les plus compromettants, sans se soucier d’examiner en profondeur les questions auxquelles ils se rapportaient[8].
Ce fait apparut en pleine lumière le 18 février 1946, lorsque l’un des avocats généraux soviétiques, le colonel Smirnov, présenta la copie d’un rapport allemand concernant des atrocités commises à l’Est par des policiers allemands (TMI, VII, 36).
Le Président demanda quelle était l’identité de l’expéditeur, quelle était celle du destinataire et, surtout, si une réponse avait été apportée à ce rapport. Car il est évident qu’en pleine guerre, des atrocités peuvent être commises ; l’important est de savoir ce qui les a provoquées et si elles ont été condamnées par l’échelon supérieur.
L’avocat général, le Colonel Smirnov, fit cette réponse savoureuse :
Monsieur le Président, je ne pourrai répondre à ces questions que dans quelques jours. Ces sujets me sont inconnus et doivent tout d’abord être étudiés plus à fond. Je ferai entreprendre des recherches sur la question et donnerai au Tribunal une réponse, de même que je lui fournirai les documents correspondants [TMI, VII, 536].
Le lendemain, L. N. Smirnov revint sur le sujet. A propos d’une éventuelle réponse, il ne put que déclarer :
[…] je me suis adressé à Moscou où se trouve cette correspondance. Il n’y a dans les archives que des extraits de cette correspondance ; le reste se trouve dans d’autres archives. Nous les avons fait rechercher et, dès que nous aurons obtenu des renseignements précis, j’en ferai part au Tribunal. Cela pourra prendre un jour ou deux [TMI, VII, 563-4].
C’était avouer qu’on avait « piqué » un ou deux documents accusateurs sans chercher à connaître ni le fond de l’affaire ni, surtout, son dénouement. J’ajoute que dans les jours qui suivirent, l’avocat général soviétique garda le silence sur cette question qui, finalement, tomba dans l’oubli.
Telles étaient les méthodes utilisées à Nuremberg.
Notons d’ailleurs que le principe d’une instruction uniquement à charge fut revendiqué haut et fort par R. Jackson. Après que plusieurs avocats eurent protesté sur la façon dont étaient présentées les accusations - documents lus de façon fragmentaire afin de leur donner un sens sinistre, faits et documents à décharge occultés, etc, - le procureur général américain rétorqua :
D’après le Statut, notre devoir est de présenter les charges de l’accusation. En aucun cas je ne servirai deux maîtres [TMI, III, 555].
L’ancien ministre des Affaires étrangères d’Hitler J. von Ribbentrop avait donc raison lorsque, peu avant d’être exécuté en octobre 1946, il écrivit :
Le ministère public n’a fait état que des documents à charge et il les a utilisés partialement ; par contre, il a sciemment passé sous silence les documents à décharge et ne les a pas communiqués à la défense[9].
La Défense largement handicapée
Cette façon d’agir aurait pu se comprendre si les documents saisis - et tous les autres entre les mains des vainqueurs - avaient également été mis à la disposition de la Défense et si cette dernière avait bénéficié des mêmes moyens que l’Accusation pour les étudier.
Or, c’est tout le contraire qui advint :
A) Toutes les archives restèrent à la disposition exclusive des vainqueurs et seuls les documents choisis par l’Accusation furent transmis aux avocats. L’article 16a du Statut du TMI prévoyait en effet :
L’Acte d’accusation comportera les éléments complets spécifiant en détail les charges relevées à l’encontre des accusés. Une copie de l’Acte d’accusation et de tous les documents annexes, traduits dans une langue qu’il comprend, sera remise à l’accusé dans un délai raisonnable avant le jugement. [TMI, I, 15-6]
Le 20 novembre 1945, le Président confirma en déclarant :
Le Tribunal a appris avec satisfaction les mesures prises par les Procureurs Généraux pour permettre aux avocats de prendre connaissance des documents sur lesquels est basée l’accusation, afin que les accusés aient toute facilité pour se défendre équitablement [TMI, II, 36].
Certes, l’article 16e donnait le droit aux prévenus « d’apporter au cours du procès […] toutes preuves à l’appui de leur défense » (TMI, I, 16) ; ce droit impliquait celui de demander tous les documents voulus qui étaient alors entre les mains des vainqueurs.
Cependant :
- Certains documents capitaux pouvaient être ignorés des accusés qui, dès lors, n’avaient pas idée de les demander. Seule une recherche dans les archives aurait permis de les découvrir ;
- Des milliers de questions étant abordées par l’Accusation, il aurait fallu au prévenu une mémoire hors du commun pour se rappeler tous les documents utiles dans le cadre des réponses à formuler ;
- Suite aux saisies et aux destructions, de nombreux documents avaient été perdus ;
- De nombreux documents alliés ne furent pas produits malgré la demande des avocats. Citons par exemple la note polonaise du 28 août 1939 au gouvernement britannique ainsi que les directives adressées à la même époque par ce gouvernement à son ambassadeur à Varsovie. Deux documents capitaux pour éclairer les responsabilités dans le déclenchement de la guerre. A Nuremberg, les défenseurs de J. von Ribbentrop demandèrent en vain leur production[10].
On le voit : le droit concédé aux accusés était, dans une large mesure, parfaitement illusoire. Quand on a vécu une période de sept ans (1933-1939) si riche en événements et que l’on a ensuite connu six ans de guerre dont trois particulièrement éprouvants (1943-1945), on ne peut se souvenir ni de tout ce qui s’est passé, ni de tous les papiers qui ont été rédigés. Seule une étude de plusieurs années, avec des équipes compétentes, aurait permis de mettre à profit les archives, saisies ou non, afin de reconstituer une chronologie objective des événements. Mais les avocats n’avaient pas accès aux pièces.
B) J’ajoute - et c’est là mon deuxième point - que même s’ils y avaient eu accès, l’équité n’en aurait pas pour autant été rétablie. En effet, de mai à septembre 1945, les Alliés avaient disposé de plusieurs mois et d’équipes compétentes pour fouiller dans les liasses de documents afin de préparer l’acte d’accusation.
Les avocats allemands, pour leur part, agissaient seuls (ou parfois avec un collaborateur) et n’étaient arrivés que très peu de temps avant l’ouverture du procès. Ils devaient donc mener leurs recherches en solitaire alors que la plupart de leurs journées étaient prises par les audiences et les entretiens avec leurs clients. Autant dire que même s’ils avaient pu accéder à toutes les archives, leurs possibilités d’enquêtes auraient été passablement réduites.
Cette inégalité dans l’accès aux archives et dans la possibilité d’enquêter apparaît nettement lorsque l’on se reporte aux listes des pièces présentées par les différentes parties pendant le procès. Alors que l’Accusation put produire plus de 10 000 documents, la Défense en présenta moins de 3 000 (TMI, XXIV, 373).
La Défense ne peut réfuter de fausses accusations
En conséquence, l’Accusation put à bien des reprises formuler de fausses accusations que, faute de moyens, la Défense ne put réfuter. Un exemple typique - que j’ai déjà exposé - concerne l’ultime tentative de médiation italienne pour sauver la paix en septembre 1939 (pour plus d’informations, voir l’article »Le mythe des démocraties acculées à la guerre »).
Sachant qu’à Nuremberg, l’Allemagne était accusée d’avoir, dans le cadre d’un complot pour une hégémonie mondiale, mené des guerres d’agression, cet épisode de notre Histoire était capital. Car le Droit international avait toujours été très clair. D’accord avec des théologiens comme saint Augustin, saint Thomas d’Aquin ou François Vittoria selon lesquels une guerre était juste quand elle était conduite pour réparer une grave injustice subie[11], le Droit international moderne précisait :
Le véritable agresseur n’est pas celui qui attaque le premier, mais celui qui rend la guerre inévitable[12].
Or, ne pouvait-on pas dire qu’en torpillant l’ultime offre de médiation italienne les 1er et 2 septembre 1939, l’Angleterre avait rendu la guerre inévitable, se révélant donc l’agresseur dans cette affaire ?
Afin que personne ne soit tenté de conclure ainsi, l’Accusation évoqua à sa façon ces journées cruciales.
Le 6 décembre 1945, le substitut du procureur général britannique, le lieutenant-colonel Griffith-Jones, produisit deux documents réunis sous la cote PS-1831 : le télégramme du 2 septembre dans lequel Mussolini exposait à Hitler son projet de médiation en trois points (armistice, réunion et solution avantageuse du différend germano-polonais) et la réponse d’Hitler le 3 septembre dans la soirée (TMI, III, 269-72).
Cette façon de présenter les événements occultait toutes les manœuvres de l’Angleterre entre le 31 août et le 2 septembre pour torpiller cette ultime tentative de médiation. Elle laissait au contraire croire que 24 heures après l’invasion de la Pologne, Mussolini avait soudainement voulu ramener Hitler à la raison mais que celui-ci avait refusé.
Naturellement, les manœuvres britanniques avaient été connues en Allemagne. Dans un livre paru sous l’Occupation et intitulé : Le Livre Jaune français accuse ses auteurs, le professeur allemand de Droit international Friedrich Grimm avait écrit :
Finalement, le projet de conférence italien fut torpillé par l’Angleterre qui exigea le retrait des troupes de Pologne. A cet égard le comte Ciano avait déclaré qu’il ne s’estimait pas en mesure de transmettre à l’Allemagne une semblable demande. Ce qui était également l’avis de Mussolini (Livre Jaune, N° 363, p. 342)[13].
Tout était donc parfaitement connu des Allemands. Cependant, des accusés présents à Nuremberg seul Joachim von Ribbentrop avait été mêlé, d’assez loin, à ces discussions.
La lecture de ses Mémoires confirme qu’il n’en savait quasiment rien ; seules six lignes y sont consacrées au chapitre intitulé : « la déclaration de guerre » (p. 158).
En conséquence, à Nuremberg, l’ancien ministre des Affaires étrangères allemand n’éleva aucune objection et, faute de documents pour la réfuter, l’Accusation put imposer sa version mensongère des faits.
La magie de l’article 21
Mais il y avait plus grave encore. L’article 21 du Statut du Tribunal énonçait :
Le Tribunal n’exigera pas que soit rapportée la preuve de faits de notoriété publique, mais les tiendra pour acquis. Il considérera également comme preuves authentiques les documents et rapports officiels des Gouvernements des Nations-Unies, y compris ceux dressés par les Commissions établies dans les divers pays alliés pour les enquêtes sur les crimes de guerre ainsi que les procès-verbaux des audiences et les décisions des tribunaux militaires ou autres tribunaux de l’une quelconque des Nations Unies [TMI, I, 17].
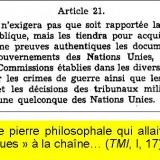
L’Accusation pouvait donc citer une myriade de « rapports » et de « jugements » émanant des « commissions » ou des « tribunaux » le plus divers et accusant les Allemands de tout et n’importe quoi. Grâce à la magie du Statut du TMI, les (prétendus) faits rapportés devenaient aussitôt « prouvés ».
L’Accusation soviétique utilise l’article 21
Le Ministère Public soviétique fit largement usage de cet article.
L’après-midi du 14 février 1946 fut, à ce titre, mémorable. L’avocat général soviétique le colonel Smirnov déposa des documents en rafales, censés prouver la « bestialité des fascistes hitlériens ».
 Citons, entre autres, le rapport d’une Commission extraordinaire d’État pour la recherche des crimes commis par les Allemands dans la région de Lwow (URSS-6b). On y apprenait que des petits enfants Soviétiques auraient été mis à la disposition des Jeunesses hitlériennes afin de servir de « cibles vivantes » dans le cadre d’entraînement aux tirs (TMI, VII, 452).
Citons, entre autres, le rapport d’une Commission extraordinaire d’État pour la recherche des crimes commis par les Allemands dans la région de Lwow (URSS-6b). On y apprenait que des petits enfants Soviétiques auraient été mis à la disposition des Jeunesses hitlériennes afin de servir de « cibles vivantes » dans le cadre d’entraînement aux tirs (TMI, VII, 452).
Au camp de Janov, les prisonniers auraient été immergés dans des tonneaux remplis d’eau froide jusqu’à ce que mort s’ensuive, réduits en pièces par des chiens féroces, choisis pour servir de cibles vivantes, pendus par les pieds puis écartelés ; les enfants d’un mois à trois ans auraient été noyés, les femmes déshabillées et pendues par les cheveux jusqu’à ce qu’elles en meurent (Ibid., pp. 453-4).
Dans ce rapport, on lisait également :
Le commandant du camp de Janov, l’Obersturmführer Willhaus, avait l’habitude de tirer avec un pistolet automatique du balcon de son bureau sur les prisonniers travaillant dans les ateliers, par amour du sport et pour amuser sa femme et sa fille. Parfois, il donnait le pistolet à sa femme qui tirait à son tour sur les prisonniers. De temps en temps, pour faire plaisir à sa petite fille de 9 ans, Willhaus donnait l’ordre de lancer en l’air des enfants de deux à quatre ans et tirait sur eux. Sa fille applaudissait en criant : « Encore, papa, encore » et il recommençait. Les détenus étaient exécutés sans raison, souvent à la suite d’un pari. Un témoin, Madame Kirschner, raconta à la Commission d’enquête que le commissaire de la Gestapo, Wepke, fit avec les autres bourreaux du camp le pari qu’il couperait un jeune garçon en deux d’un seul coup de hache. Ceux-ci ne voulurent pas le croire : il attrapa dans la rue un petit garçon de dix ans, le força à se mettre à genoux, lui dit de se cacher la figure dans les mains. Il fit semblant de donner le coup, pour s’essayer, rectifia la position de la tête de l’enfant et le coupa en deux d’un seul coup de hache. Les hitlériens le félicitèrent chaleureusement et lui serrèrent la main.
En 1943, au 54ème anniversaire de Hitler, le commandant du camp de Janov, Wilhaus, choisit 54 prisonniers de guerre qu’il abattit lui-même [Ibid., p. 455].
Le colonel Smirnov cita ensuite un rapport de la Commission extraordinaire soviéto-polonaise pour la recherche des crimes de guerre commis par les Allemands dans le camp de Majdanek (URSS-29).
Les SS, y disait-on, tuaient leurs victimes
D’un coup de crosse dans la nuque, d’un coup de pied dans le ventre, ou dans l’aine » (Ibid., p. 456).
Autre méthode : la noyade
Dans l’eau sale qui venait des salles de bain par un étroit canal. La tête de la victime était plongée dans l’eau sale et un SS la maintenait sous sa botte jusqu’à ce que mort s’ensuive » (Ibid., p. 456).
A signaler aussi :
Les déportés pendus à des crochets situés à 2 m du sol jusqu’à ce que mort s’ensuive (Ibid., p. 457).
Quant aux enfants, on les exterminait ainsi :
On prenait un petit enfant par une jambe, on maintenait l’autre avec les pieds, puis on déchirait l’enfant » (Id.).
Dans la foulée, l’avocat général produisit une note du Commissaire du Peuple pour les Affaires étrangères (URSS-51). Les Allemands y étaient accusés de meurtres brutaux un peu partout, comme à Lwow :
Massacres puis exposition publique des victimes, le clou de cette exposition étant une femme avec son enfant fixé sur elle à l’aide d’une baïonnette
à Krasnoya-Polyana :
Affamement de la population
à Byely-Rast :
Un adolescent de 12 ans criblé de balles, une femme avec ses trois enfants assassinés par des soldats ivres
à Slobin :
Un enfant de deux ans tué parce que ses pleurs troublaient le sommeil des Allemands
à Semionovskoye :
Une femme enceinte violée et égorgée après avoir eu les seins percés
etc, etc (Ibid., pp. 458-60).
Avec un cynisme révoltant quand on songe aux viols commis sur les Allemandes à partir de 1944, le colonel Smirnov poursuivit :
Les violences sauvages commises partout contre les femmes témoignent de la profonde corruption morale des criminels. Je cite le passage de la note que le Tribunal trouvera à la page 4 du livre de documents.
Les femmes et les jeunes filles sont sauvagement violentées dans tous les territoires occupés. Dans le village ukrainien de Borodayevka […], les fascistes violèrent les unes après les autres toutes les femmes et les jeunes filles. Dans le village de Beresovka, des soldats allemands ivres violèrent toutes les femmes et les jeunes filles entre 16 et 30 ans.
A Smolensk, le commandement allemand ouvrit dans un des hôtels de la ville une maison de tolérance pour les officiers où furent traînées par les cheveux des centaines de femmes et de jeunes filles.
Partout, les sauvages bandits allemands font irruption dans les maisons, violent les femmes et les jeunes filles sous les yeux de leurs parents et de leurs enfants, et les assassinent sur place.
[…] En Russie Blanche, près de la ville de Borissov, 75 femmes et jeunes filles, fuyant l’approche des troupes allemandes, tombèrent cependant entre leurs mains. Les Allemands violèrent et tuèrent sauvagement 36 d’entre elles. Une jeune fille de 16 ans, L.I. Melchukova, fut, sur l’ordre de l’officier allemand Hummer, conduite dans les bois par des soldats qui la violèrent. Quelques temps après, d’autres femmes amenées elles aussi dans le bois purent voir Melchukova clouée sur des planches près d’un bosquet. Les Allemands lui coupèrent les seins sous les yeux de ces femmes […]
Puis il cita le rapport de la Commission extraordinaire d’État pour la ville de Kiev, accusant les Allemands d’avoir tué
100 000 personnes à Babi-Yar (Ibid., p. 462).
Les documents se suivaient donc, exposant des faits le plus souvent invérifiables faute d’informations assez précises ou faute de moyens d’investigation.
L’hypocrisie révoltante du Tribunal
Voilà pourquoi le lendemain matin, alors que le procureur soviétique allait reprendre sa litanie, l’avocat de l’accusé Kaltenbrunner se leva et protesta. S’adressant aux juges, il lança :
Première demande : je voudrais qu’on interdise, conformément à l’article 21 du Statut, la lecture des déclarations qui ne contiennent aucune indication concernant les sources des faits exposés. Deuxièmement, je demande qu’on interdise la lecture des déclarations qui ne contiennent que des indications sommaires et qu’on autorise seulement cette lecture quand l’autorisation du témoin est possible [Ibid., p. 465].
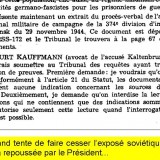
Le Président rejeta cette demande et s’expliqua ainsi :
Les avocats auront la possibilité, au moment opportun, de critiquer toutes les preuves qui auront été déposées par le Ministère Public. Ils pourront signaler si, selon eux, telle preuve a été apportée par haine ; ils pourront critiquer comme ils le voudront les preuves soumises, mais en temps voulu.
L’article 21 est parfaitement clair et enjoint au Tribunal d’accorder une valeur probatoire à tous les documents qui sont cités et cet article fait allusion aux procès-verbaux et aux conclusions des tribunaux militaires ou autres de l’une quelconque des Nations Unies. Il s’agit ici d’un procès-verbal et des conclusions d’un tribunal militaire soviétique. C’est pourquoi le Tribunal a le devoir exprès que lui dicte l’article 21, de leur accorder une valeur probatoire. Rien n’empêche les avocats de la Défense, lorsqu’ils feront leurs plaidoiries, de critiquer les preuves sur lesquelles sont établis ce procès-verbal et ces conclusions, mais dire que ces preuves ne devraient pas être admises me paraît à moi, et je crois aux autres membres du Tribunal, non valable [Ibid., pp. 466-7].
Sachant qu’il ne pourrait s’opposer à cette décision, l’avocat, Me Kaufmann, se contenta de répondre :
Je vous remercie (Ibid., p. 467).
Mais en rejetant sa demande, le Tribunal montrait sa duplicité. En effet, un avocat pourrait toujours dire que, selon lui, telle ou telle preuve avait été apportée par haine. Cela n’aurait strictement aucune valeur. Le seul moyen de « critiquer les preuves soumises » était, dans chaque cas, d’envoyer une commission d’enquête sur le terrain afin de vérifier.
Or, à Nuremberg, c’était impossible pour deux raisons :
- Les avocats n’avait pas les moyens de réunir des équipes d’enquêteurs pour les envoyer en URSS à des fins de contre-expertise ;
- Les eussent-ils eus, les faits étaient beaucoup trop nombreux pour pouvoir être vérifiés dans le cadre d’un procès « expéditif ».
En conséquence, le droit donné aux avocats de « critiquer, comme ils le voudr[aient] les preuves soumises » était totalement illusoire. Comment, par exemple, démonter que les viols prétendument commis dans la région de Borissov n’avaient jamais été perpétrés ? Comment démontrer qu’à Janov, le commandant n’avait pas tué des bébés pour faire plaisir à sa fille ? Comment démontrer que l’histoire des 100 000 massacrés dans le ravin de Babi-Yar était un mensonge ?
Sans enquête sur le terrain, sans contre-expertise et sans contre-interrogatoire des témoins, c’était rigoureusement impossible.
L’Accusation soviétique en profite
Le procureur soviétique put donc poursuivre sa production de documents. Il commença par mentionner les « aveux » faits par un soldat allemand devant un tribunal de campagne militaire soviétique.
Celui-ci racontait que
A ses « moments perdus », il fusillait « pour [son] propre compte des prisonniers de l’Armée rouge ainsi que de paisibles citoyens soviétiques » et que pour cela, il avait été récompensé en devenant caporal-chef un an avant la date prévue (Ibid., pp. 467-8).
Puis vint le URSS-87, le verdict d’un autre tribunal soviétique qui avait jugé dix soldats allemands. Il reprenait les résultats d’une « enquête médico-légale » selon laquelle dans la région de Smolensk, 80 fosses avaient été ouvertes contenant « 135 000 cadavres de femmes, d’enfants et d’hommes soviétiques » massacrés par les Allemands : trente fois Katyn (Ibid., p. 468) !
Parmi les accusés, le soldat Mueller fut reconnu coupable d’avoir tué 96 citoyens soviétiques, violé 32 femmes dont « quelques jeunes filles âgés de quatorze à quinze ans » (Ibid., p. 470).
Au cours de cet exposé, de vieux bobards issus de la première guerre mondiale ressortirent, comme celui des enfants aux mains coupés. S’appuyant sur une note du Commissaire du Peuple pour les Affaires étrangères en date du 27 avril 1942, le document URSS-6c déclarait :
Des enfants étaient coupés en deux avec des scies rouillées (Ibid., p. 544).
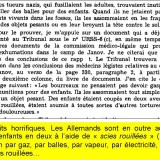
Plus loin, il précisait :
Parmi les cent enfants blessés et mutilés par les tortures, actuellement en traitement à l’hôpital Roussakovski à Moscou et qui avaient été victimes de la terreur hitlérienne dans la région maintenant libérée de Moscou, se trouvent par exemple : un garçon de 14 ans, Vanya Gromov, du village de Novinka, à qui les nazis avaient coupé la main droite avec une scie rouillée après l’avoir attaché à une chaise avec des courroies. Vania Krnkov, 12 ans, du village de Kryukovo, région de Koursk, auquel ils ont coupé les mains et qu’ils ont chassé vers les lignes russes, perdant abondamment son sang [Ibid., pp. 544-5].
Le colonel Smirnov produisit également le document URSS-9, un rapport de la Commission extraordinaire d’État qui prétendait donner les estimations du nombre des victimes de la « barbarie nazie » dans la seule région de Kiev. Il y était question de 195 000 personnes assassinées dont 100 000 à Babi-Yar, 68 000 prisonniers de guerre et civils à Darnitza, 25 000 civils dans une seule tranchée anti-char près du camp de Syretzk, 800 malades mentaux dans un hôpital psychiatrique, 500 « paisibles citoyens soviétiques » au monastère de Pechersk et 400 « paisibles civils » au cimetière de Loukeanov (Ibid., p. 557).
Grâce à la magie de l’article 21 du Statut du TMI, tous ces faits devenaient « prouvés » et toutes ces estimations devenaient « exactes ». Oui, quand ils ne se battaient pas, les soldats allemands passaient leur temps à assassiner de paisibles citoyens, à violer, à clouer sur des planches, à percer les seins, à couper les mains des enfants avec des scies rouillées, à multiplier les Katyn par six, seize, voire par trente.
Face à un tel déluge d’accusations, que pouvaient faire les avocats ? Rien.
La porte ouverte à tous les faux témoins
On ne sera donc pas surpris que dans tous ces procès d’après-guerre - que ce soit à l’instruction ou lors des audiences - de nombreux « témoins » soient apparus qui, par ressentiment, par haine ou par désir de vengeance, mentaient afin de noircir les accusés et, à travers eux, un régime honni. Ils savaient pouvoir bénéficier d’une totale impunité.
Les cas de J.-M. Veith et de Mme Vaillant-Couturier à Nuremberg sont loin d’être isolés. Témoignant devant la commission d’instruction du procès de Bergen-Belsen, une ancienne déportée polonaise à Auschwitz, Regina Bialek, déclara :
Le 25 décembre 1943, j’étais atteinte du typhus et j’ai été choisie en compagnie d’environ 350 autres femmes lors d’une sélection par les docteurs Mengele et Tauber. J’ai été déshabillée et prise par un camion jusqu’à la chambre à gaz. Il y avait sept chambres à gaz à Auschwitz. Celle-ci était au sous-sol et le camion pouvait descendre par un plan incliné et arriver tout droit dans la chambre à gaz. Là, nous avons été jetées avec brusquerie au sol. La pièce faisait environ 100 m² et de petites lampes sur les murs l’éclairaient faiblement. Quand la chambre fut pleine, un chuintement se fit entendre, venant du milieu du sol, et le gaz arriva dans la pièce. Après ce qui apparut dix minutes, quelques victimes commencèrent à mordre leurs mains, de la mousse apparut à leur bouche, du sang sortit de leurs oreilles, de leurs yeux et de leur bouche, et leur figure devint bleue. Je souffrais de ces symptômes avec en outre une impression de serrement dans la poitrine. J’étais à moitié consciente quand le docteur Mengele cria mon numéro [de tatouage] et que je fus traînée hors de la chambre à gaz. J’attribue mon sauvetage au fait que la fille d’une de mes amies qui était une aryenne et un docteur à Auschwitz, m’avait vu transportée jusqu’à la chambre à gaz et l’avait dit à ma mère qui appela immédiatement le docteur Mengele. Apparemment, il s’aperçut qu’en tant que prisonnière politique, j’avais une plus grande valeur vive que morte et j’ai été délivrée[14].
Ce témoignage émanant d’une personne qui avait vu, de l’intérieur, un gazage homicide, devrait aujourd’hui être cité partout. Or, il est totalement oublié. Pourquoi ? Parce que la description de la prétendue « chambre à gaz » et des effets du Zyklon B sur les personnes sont carrément fantaisistes.
R. Bialek faisait partie de la cohorte de faux témoins qui, à Nuremberg et ailleurs, débitèrent leurs infâmes calomnies en toute impunité afin de noircir les accusés.
La stratégie des accusés
Plus grave cependant : dans cette atmosphère de règlement de compte et de mise à mort du vaincu, que pouvaient faire les sans grade et les subalternes qui, d’une façon ou d’une autre, s’étaient compromis avec le régime national-socialiste ?
S’ils voulaient sauver leur peau, ils n’avaient qu’une possibilité : admettre les terribles accusations portées de manière générale - cela afin de se concilier le Tribunal - mais souligner qu’eux-mêmes n’y avaient pas pris part ou n’y avaient participé que dans une très faible mesure.
Une autre excuse consistait à invoquer des ordres supérieurs ou la contrainte irrésistible. Ces stratégies furent adoptées par de nombreux accusés au procès de Bergen-Belsen, par l’ancien commandant de Mauthausen Franz Zeireis, par l’ancien commandant du camp de Ravensbrück Johan Schwarzhuber, par le Dr Krebsbach (un ancien de Mauthausen), par Ruth Closius-Neudeck (ancienne gardienne du camp de Ravensbrück), par les anciens Waffen-SS au procès d’Oradour.
A chaque fois, le discours était le même :
Oui, ceux que nous avons servi étaient des criminels, vous voyez, je ne suis pas un nazi fanatique, je suis de votre côté. Mais moi, je n’ai presque rien fait, et si j’ai commis quelques crimes, c’était par ordre ou sous la contrainte exercée par ces nazis fanatiques qui nous avaient embrigadés. Ce sont eux les véritables responsables, pas moi.
Tel fut la vraie nature du « procès » de Nuremberg.
____________________________________________________________________
[1] Voy. TMI, I, 11, « Statut du Tribunal Militaire International », art. 2.
[2] Cité par Mgr de Solages dans La Théologie de la Guerre Juste (éd. Desclée de Brouwers, 1946), p. 88.
[3] Notons que le principe de médiation n’était pas nouveau : chez les Grecs, Thémistocle avait été élu arbitre dans un litige entre Corinthe et Corcyre ; Thucydide considérait comme un crime de tuer un ennemi disposé à accepter un arbitre. Chez les Romains de la première époque, l’arbitrage portait le nom de « reciperatio ». Au moyen âge, Louis XI fut plusieurs fois arbitre, tout comme les docteurs des universités italiennes dans les disputes des États italiens. Citons également le pape Alexandre VI qui, par sa fameuse sentence prononcée le 4 mai 1493, clôt la querelle entre le Portugal et l’Espagne à propos des terres découvertes dans le Nouveau Monde.
[4] Voy. « Convention (I) pour la résolution pacifique des disputes internationales », La Haye, 29 juillet 1899, art. 2-8 (bons offices et médiation), art. 20 et ss. (Cour permanente d’arbitrage).
[5] Voy. « Convention (II) pour la résolution pacifique des disputes internationales », La Haye, 18 octobre 1907, art. 41 et ss.
[6] Voy. A. G. Heffter, Le Droit international de l’Europe (A. Cotillon et Cie, Paris, 1883), p. 238, note 7.
[7] Voy. Victor M. Maurtua, James Brown Scott et Jean Efremoff, Nouvelles tendances de la Conciliation Internationale (Centre Européen de la Dotation Carnegie, Publications de la Conciliation Internationale, 1933, « Avant-projet de convention instituant un organe mondial de conciliation », p. 166.
[8] « Le ministère public n’a fait état que des documents à charge et les a utilisés avec partialité » (voy. Joachim von Ribbentrop, De Londres à Moscou. Mémoires [éd ; B. Grasset, 1954], p. 228).
[9] Voy. J. von Ribbentrop, op. cit., p. 228.
[10] Voy. J. von Ribbentrop, op. cit., pp. 150 et 152.
[11] « On a coutume de définir guerres justes celles qui punissent des injustices, quand il y a lieu, par exemple, de châtier une nation, ou une cité, qui a négligé soit de punir un tort commis par les siens, soit de restituer ce qui a été enlevé injustement » (voy. saint Augustin, Quaestiones in Heptateuchum, VI, 10).
[12] Voy. A. G. Heffter, op. cit., p. 252, note.
[13] Voy. F. Grimm, Le Livre Jaune français accuse ses auteurs (s.l.n.d.), pp. 69-70.
[14] Voy. War crimes trials, vol. II, « The Belsen Trial » (William Hodge and Cie, Londres, 1946), p. 657.